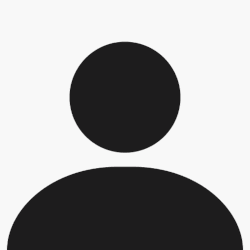Florence Burgat a écrit :
Tribune. Dans l’Avenir d’une illusion, Freud qualifie la religion de « névrose obsessionnelle universelle de l’humanité ». Ainsi, en ne parvenant pas à se défaire d’une relation à une altérité toute-puissante, l’humanité n’accède pas à son autonomie et demeure fixée à un stade infantile. Empruntée, son identité s’inscrit dans une dépendance qui s’ignore cependant comme telle. Obsessionnelle est encore cette névrose car elle s’accompagne de l’effectuation impérative de rites, par définition toujours maniaques, destinés à apaiser l’angoisse et qui doivent être indéfiniment répétés – en vain.
Le parallèle entre cette structure névrotique et l’impossibilité pour l’humanité de renoncer à la viande, au moment où non seulement elle peut mais doit s’en passer pour des raisons impératives qui engagent son avenir même, est frappant. Comment expliquer cette singulière résistance alors que des arguments rationnels d’ordre écologique, sanitaire et éthique commandent l’abandon de l’élevage ? Longtemps, les humains durent se nourrir de ce qu’ils trouvaient, pratiquant le charognage, la cueillette, la chasse de survie. L’humanité fut, à l’égard de la nourriture, dans une situation en tout point différente de celle qui est la sienne aujourd’hui. Mais c’est au moment où elle pouvait se passer de chair animale qu’elle universalisa un système, devenu gigantesque, en raison d’une demande pléthorique que servent des avancées scientifiques et techniques.
Louanges un peu maniaques
Une simple affaire de cuisine et de goût ne saurait expliquer chez certains la panique, chez d’autres la virulence que suscite la perspective d’une fin de la boucherie, alors que celle-ci n’a plus rien à mettre à son crédit. La filière bouchère n’en vient-elle pas à brandir, tel un argument dirimant, l’entretien des prairies ?
Pourtant, derrière cette image d’Epinal se profile la lointaine déforestation nécessitée par la culture des tourteaux de soja ; derrière le calme des étals, le bruit sourd des animaux qui s’effondrent ; derrière les produits laitiers, le veau, l’agneau et le chevreau, tués dès après la montée de lait ou envoyés dans des « ateliers d’engraissement » – toutes choses que les défenseurs de « la viande » laissent dans l’ombre. Ils concourent ainsi à faire de ce terme un pur signifiant qui ne renvoie qu’à lui-même, une tautologie. Car il ne s’agit jamais que d’évoquer des denrées désormais impassibles, livrées à la cuisine aux louanges un peu maniaques dont elle fait l’objet dès lors qu’elle est carnée.
Parmi les curiosités qui accompagnent cette quasi-vénération pour la chair animale, se distinguent les concerts de musique classique donnés dans quelques boucheries choisies, au milieu, donc, de morceaux étalés et de carcasses suspendues…
Ce qui singularise l’aliment carné – quoi que l’on dise, quoi que l’on taise – ce n’est ni son goût ni sa consistance, bientôt imités à la perfection, mais le fait de tuer. « Tuer des êtres vivants pour s’en nourrir pose aux humains, qu’ils en soient conscients ou non, un problème philosophique que toutes les sociétés ont tenté de résoudre », écrit Claude Lévi-Strauss.
Ajoutons que l’un des mérites des discussions autour de la viande cellulaire est de clarifier ce à quoi nous tenons vraiment dans « la viande ».
Vie psychique
Ce ne sont pas les réactions corporatistes, simple défense d’intérêts économiques,
qui suscitent l’étonnement, mais celles qui manifestent une angoisse devant l’abîme qui s’ouvrirait si l’humanité cessait de manger les animaux – et donc de les tuer. Car
c’est bien ce nouveau statut auquel accéderaient alors, presque mécaniquement, les animaux, qui génère de l’angoisse. Perdre cette emprise, absolue, qui en aucune autre occurrence n’a atteint un tel point d’acmé, par le nombre de victimes comme par le type de mainmise qui façonne génétiquement les corps et mutile des animaux doués d’une vie psychique, voilà ce que nous ne voudrions pas.
Le fait que ces animaux, domestiqués de longue date, puissent aisément entrer dans une relation d’affection avec les humains, comme les refuges accueillant quelques rescapés le montrent, n’est pas un détail. D’aucuns l’ont justement souligné : nous mangeons les animaux qui ont un visage, qui ont des yeux.
Or n’entend-on ou ne lit-on pas que ce sont leurs « soi-disant défenseurs qui veulent se débarrasser des animaux », que sans boucherie « nous ne serions plus humains », qu’un terme mis à cette activité serait « le plus grand zoocide de l’histoire de l’humanité » ?
La boucherie serait notre éternelle planche de salut ; son terme une double catastrophe pour l’humanité et pour les animaux !
Fiction d’un meurtre fondateur
Ces propos au ton millénariste, ces menaces de la « perte de notre identité », la haine déployée contre ceux qui renoncent à manger les animaux évoquent le fanatisme religieux et son angoisse face à l’émancipation. Car il s’agit bien, avec la fin de la boucherie, d’une double émancipation. On connaît les liens entre la religion et le sang versé, sorte de pacte dont l’humanité ne pourrait ni ne voudrait sortir. Une certaine exégèse a du reste doté le sacrifice sanglant de très hautes vertus : il serait au fondement des sociétés humaines et contiendrait la violence. Mais la fiction d’un meurtre fondateur ouvre le cycle d’une répétition infinie…
Tout se passe comme si, à suivre les défenseurs de la boucherie, l’humanité allait perdre une identité qui se joue dans un rapport en effet séculaire et de plus en plus meurtrier aux animaux.
Une relation malade, proprement névrotique, qui ne sait faire que tuer et ne parvient pas à envisager un type de relation dont les protagonistes, humain et animaux, pourraient enfin dire « je ».
La viande cellulaire, que le marketing saurait déguiser en viande de boucherie par ses ruses de langage et ses images, tout comme il vend cette dernière pour ce qu’elle n’est pas parce que nous le voulons bien, apparaît alors comme une réponse qui tient cette névrose pour inguérissable.
Je me demande si Burgat croise Porcher de temps à autre dans le cadre de l'INRA... et si cette dernière rase les murs ou va jusqu'à se réfugier aux gogues quand ça se produit