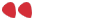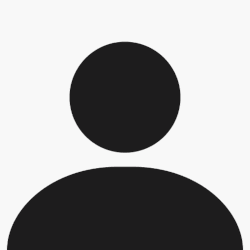Pour justifier la persistance et même l'accroissement des souffrances privées et collectives, malgré l'identification docile du public aux injonctions de ses héros fantasmatiques, le spectacle est souvent contraint de mettre en scène d'autres héros incarnés par divers acteurs, et porteurs de valeurs tout aussi inconciliables mais diamétralement opposées à celles du héros positif. Ces personnages public affichent leur mépris pour l'organisation du monde actuel, en dénoncent les fondements, encouragent la révolte ; et, simultanément, terrorisent les populations civiles, font l'apologie de régimes esclavagistes, organisent des massacres collectifs.
La fondamentale duplicité du spectacle et de ses héros ambigus se retrouve dans la nouvelle classe dominante chargée d'organiser la production d'un tel spectacle. La matière première qu'elle a pour tâche de recueillir, de transformer, de gérer et de restituer sous forme d'images, est constituée par les désirs, toujours insatisfaits - désir de liberté et de dignité - de ceux qui sont économiquement condamnés à faire fonctionner ce système, au prix même de leur liberté et de leur dignité. Et cette nécessité leur interdit définitivement de satisfaire de tels désirs. Ceux qui sont privés de leur humanité sont aujourd'hui contraints de fabriquer, à leur propre usage, des images de cette humanité perdue.
Dans les pays les plus modernes, la classe gestionnaire se présente donc d'abord comme porte-parole attentif des désirs et des revendications collectives ; et simultanément comme créatrice de structures matérielles et politiques censées satisfaire ces désirs et ces revendications, structures évidemment conformes à l'organisation politico-industrielle actuelle qui en exclut la réalisation effective.
Cette classe se scinde donc habituellement en deux ensembles gouvernementaux. Les membres du premier groupe, parfois issus de la classe laborieuse mais délivrés de toute activité productrice, se présentent comme les représentants et les courroies de transmission des exigences populaires. Les seconds, généralement issus de l'ancienne classe gestionnaire bourgeoise ou bureaucratique désormais contrainte de prendre en compte les nouveaux appétits de leur clientèle, se chargent de transformer ces rêves en réalité et de créer des objets ou des structures propres à satisfaire illusoirement de tels désirs, en s'intégrant dans le système de production moderne.
Ces deux instances dont l'une porte les revendications et l'autre les convertit en images constituent un instrument de gestion unique, dont la publicité commerciale et la propagande politique sont les articulations. Et ce qui a pu se faire passer, à une époque déjà lointaine, pour une "lutte des classes" n'est plus maintenant qu'une tenaille entre les branches de laquelle sont déchiquetés et broyés les efforts de chacun pour regagner son humanité.
Cette façon de n'être au monde que par la médiation d'images a donné lieu à d'extravagantes manifestations collectives, caractéristiques de notre époque hystérique, et que l'histoire n'avait pas revues depuis le Bas-Empire romain. L'extraordinaire importance des rassemblements sportifs, d'un bout à l'autre du monde, l'intérêt que leur accordent les médias, les violences auxquelles elles donnent lieu de la part du public, relèvent bien de l'hystérie moderne. Les spectateurs d'une exhibition sportive vivent, par procuration, un affrontement dans lequel ils s'engagent personnellement. Ils s'identifient à tel joueur, à telle équipe, et par cette identification ils connaissent d'intenses émotions. Leur joie ou leur colère peuvent être extrêmement violentes (...). Simultanément ils se mettent eux-mêmes en scène comme supporters et se font admirer comme tels. L'universalité de telles exhibitions était inconnue des siècles passés. Mais aujourd'hui, dans quelles autres circonstances moins factices pourraient être vécues de telles émotions, de tels affrontements ? Ces manifestations ont bien pour fonction de canaliser des impulsions interdites, de contrefaire une vie absente. Comment un pouvoir et ses médias ne les favoriseraient-ils pas ?
Il en est de même des divertissements musicaux actuels, qui se déroulent en outre dans les mêmes lieux que les compétitions sportives et qui sont bien différents de ce qu'étaient les concerts de musique au cours des derniers siècles. A Woodstock ou à Bercy, comme dans les rues de la "fête de la musique", des auditeurs-supporteurs s'identifient aux histrions de l'estrade et se mettent eux-mêmes en spectacle comme amateurs éclairés, recouverts de l'aura de leur modèle admirable. L'identification est si complète et le modèle si parfaitement intériorisé qu'il peut n'être aujourd'hui que fantasmé dans les rave parties comme il l'était dans l'ancien happening."
L'Europe a donc suivi sa pente, entraînant le monde entier dans son histoire singulière, et s'éloignant toujours davantage de cette façon de vivre, et de vivre ensemble, qu'elle avait pu observer en Amérique, dans les îles du Pacifique et dans d'immenses contrées où l'on ignorait tout de ses voies. Les peuples de ces territoires ont été anéantis et leurs quelques survivants sont occasionnellement exhibés dans des espèces de "réserves", de zoos humains, de parcs ethnologiques. Le reste du monde a suivi l'Europe dans son aventure technicienne, dans son genre de folie, dans sa manière d'organisation sociale.
Le rappel de ces destructions, de ces tueries, de ces désastres, n'a pas pour but de susciter des sentiments de nostalgie ou de honte. Encore moins de permettre des débats sur les profits ou les désavantages que cette histoire aurait entraînés. Il s'agit d'abord de répondre à des questions qu'il nous semble bien pertinent et urgent de poser aujourd'hui.
Quelle impulsion initiale a amené un jour l'Europe à se transformer de cette façon particulière et à contraindre par les armes le monde entier à suivre ses voies ? Quelle est la nature réelle de cette force ? Par quelles médiations l'accord s'est-il fait sur ce cheminement et sur ces réalisations ?
Personne ne se soucie certainement des réponses qu'auraient données à ces questions les peuples qui ont été anéantis, ni même de celles des civilisations impériales assujeties plus récemment à un genre de vie qu'elles n'avaient pas choisi. En revanche, les Européens, dès l'époque où ils allaient chercher ailleurs que chez eux de l'or et des esclaves, ont toujours su fournir d'excellentes raisons, philosophiques et morales, pour expliquer et justifier leur aventure exemplaire.
Tous les empires agricoles sédentaires ont connu cette organisation sociale fortement structurée et hiérarchisée. La plupart ont aussi adopté cette institution inconnue auparavant, l'esclavage humain, né avec le travail sédentaire et destiné à remplacer la population autochtone pour les tâches les plus pénibles et méprisées. Cette masse servile, généralement capturée par la caste guerrière, était parfois extrêmement abondante, particulièrement en Grèce, à Rome et, plus tard, dans les royaumes africains et dans l'empire arabo-musulman, c'est-à-dire dans les pays les plus agressivement conquérants.
Ce n'est pas leur seule personnalité ou leur machine scénique qui ont permis à Hitler ou à Staline d'entraîner des foules immenses dans les aventures que l'on sait. C'est d'abord la soif d'illusions, la gourmandise pour ce genre de représentation où chacun peut s'assigner une place avantageuse et s'inscrire dans le modèle collectif purement imaginaire que lui propose le menteur électoral, l'escroc social, le criminel politique. Le public moderne, fondamentalement hystérique, se nourrit avidement de telles images parce qu'il a définitivement occulté sa propre réalité, parce qu'il a oublié sa vérité de sujet social, parce qu'il a d'abord été expulsé de lui-même, "aliéné".
Peut-on imaginer, de même, qu'au XVIIe siècle en Europe une bande d'individus masqués soit venue commettre un massacre aveugle dans une ville, et qu'un despote avide ait réussi à convaincre les foules que les organisateurs du carnage étaient précisément ceux dont il convoitait et confisquait les richesses ? En dehors de la Rome néronienne où l'hystérie s'était quelque peu répandue avant l'écroulement de l'Empire, peut-on imaginer cela ailleurs qu'à notre époque moderne où elle s'est généralisée ? La croyance à de telles balivernes n'est possible que si elles coïncident avec un scénario social reçu, comme tout autre, avec délectation, par un public mythomane.
L'hystérie collective actuelle, avec son oubli de soi-même, sa suggestibilité, sa soif d'images et de représentations, s'et formée au cours des derniers siècles, dans des relations sociales marchandes. Dans ce type de rapport social, où le sujet est privé de sa création dans le moment même de son élaboration, où l'objet créé se présente comme autonome et comme le primum movens des relations sociales, la perte de soi-même conduit naturellement à l'hystérie. Ainsi, ce n'est pas la "société du spectacle" qui engendre la mythomanie actuelle. Cette névrose s'est forgée d'abord dans la vieille "aliénation" marchande; et elle s'est généralisée avec la mondialisation de cette aliénation.
Si l'ancien Grec se connaît non seulement comme individu, mais d'abord comme Athénien, comme membre de l'univers vivant et, à ce titre, interlocuteur des dieux, l'Amérindien du Nord n'est pas non plus un simple individu étranger au monde qui l'entoure. Il est d'abord un Sioux ou un Algonquin, et principalement un Indien. Mais il est surtout un membre de la nature et du cosmos, auquel il participe, et dont il a la pleine responsabilité par sa communication intime et quotidienne avec le "Grand Mystère".
Chez tous les peuples primitifs observés par les anthropologues, on retrouve de telles caractéristiques, aussi bien en Afrique centrale que dans les îles océaniques. Et il n'est que trop vraisemblable qu'il en était de même en Europe autrefois. Qui s'en étonnera ? Une telle conscience appartient à tout homme venant au monde. Seule une conscience moderne, forgée dans des conditions sociales bien différentes de celles du primitif, peut croire qu'une vie collective est la somme de vies individuelles associées dans une espèce de "contrat social". Dans la toute première enfance, la vie se montre d'abord sous la forme d'une mère, d'une famille, d'une tribu. Et l'enfant ne distingue pas sa propre vie de celle du monde. Ce n'est que plus tard qu'apparaît chez lui la conscience de son individualité, et, dans des circonstances sociales particulières, la perte partielle ou totale de sa conscience de "petit enfant".
Dans les civilisations impériales de l'Egypte ancienne, du Mexique et du Pérou, de la Chine ou de l'Inde, civilisations figées dans le cours de leur développement et, de ce fait, vulnérables face à celles qui poursuivaient leur chemin (la civilisation romaine d'abord, puis la colonisation européenne), on retrouve, de même, les principes de la conscience unitaire, mais non intimement vécus, extérieurs à l'individu, théorisés et concentrés au niveau de pouvoirs religieux et politiques. Pour la première fois dans l'histoire, la religion témoigne de ce qui a été perdu. Elle en témoigne extérieurement mais réellement.
La différence fondamentale entre la mentalité primitive et la mentalité moderne tient d'abord à ceci : de la fusion du primitif avec le monde qui l'entoure résulte l'identité parfaite de son univers subjectif et de son monde objectif. Le primitif connaît ses désirs comme une force agissante de l'univers, à travers lui-même, une force qui a sa source dans le monde et se manifeste en lui, c'est-à-dire dans le monde. Ses pensées et les mots qui les traduisent sont, de même, des éléments et des articulations de l'univers, ils en dessinent la trame et ils le dévoilent en lui et par lui. Pour le primitif, il n'existe aucune séparation entre ses sensations, ses désirs, ses pensées, et l'objet qui les suscite : leur sujet, leur objet, et la relation entre eux sont une seule et même chose.
Michel Bounan, La Folle histoire du monde (éditions Allia, 2006)