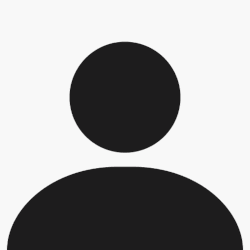Très bon article de l'humanité sur l'artiste:
Le chanteur emblématique des États-Unis est aussi celui qui a le plus décrit les désillusions du rêve américain post-Vietnam.
Depuis qu’il a accédé au statut de superstar, le " boss " navigue entre contradictions et incompréhensions. Retour sur vingt-cinq ans de carrière à l’occasion de son passage à Paris pour deux concerts, les 2 et 3 juin à Bercy.
En matière de musique comme en poésie, ou parfois quand les deux se rejoignent, la place d’une voyelle change tout. De la bannière étoilée à celle étiolée, il y a bien plus qu’une lettre déplacée, c’est une conception des États-Unis qui s’en trouve bouleversée. De ce côté-ci de l’Atlantique, on a trop souvent assimilé Bruce Springsteen aux hérauts de la première proposition. C’est dommage. Car on a ainsi enterré un artiste majeur et tout un pays dans le même cercueil des idées préconçues. Un disque, une chanson sont à l’origine de ce malentendu : Born in the USA. Quand en 1984 l’hymne martial s’est mis à tourner sur les platines planétaires, Springsteen n’était qu’une espèce de vague figure en jeans 501 et tee-shirt aux manches retroussées suant sur sa guitare en clamant des histoires d’Amérique que personne ne comprenait faute de maîtriser la langue et de décoder les mots hachés éructés par le chanteur. Pour toute une frange de la population, ces paroles qui résonnaient d’un accent farouche " né aux États-Unis, je suis né aux Etats-Unis ", ne signifiaient qu’une chose : la fierté de celui qui les chantait d’avoir vu le jour sur cette terre " du lait et du miel ", comme l’apprennent les écoliers américains. D’où les deux réactions épidermiques qui se sont affrontées en France : ceux qui reprenaient le refrain à tue-tête en rêvant de Chevrolet 1964 et ceux qui méprisaient Springsteen au nom de leur antiaméricanisme jalousement préservé comme une garantie de survie face à une hégémonie supposée. Personne ne s’est donné la peine d’écouter le sens des paroles. C’est dommage. Tout le monde aurait enfin compris Springsteen et se serait peut-être penché sur ses douze ans de carrière précédents, celle d’un folk singer qui se voulait Elvis, celle d’un petit Blanc de la côte Est cherchant à tutoyer les grands espaces de l’Ouest, celle d’un artiste sur la route chroniquant les misères des prolos arrimés à leur ville et à leur travail, celle d’un magnifique chanteur capable de fulgurances électriques et poétiques. Mais le malentendu springsteenien n’a pas seulement eu lieu à l’étranger. Les Américains furent les premiers à donner dans le panneau de Born in the USA. En pleine campagne présidentielle de 1984, Ronald Reagan et Walter Mondale s’emparèrent tout deux du refrain - sans l’accord de son auteur - pour le faire hurler dans la sono de leurs meetings. À croire que la surdité est la chose la mieux partagée par les politiciens. Que raconte donc la fameuse chanson : l’histoire d’un pauvre type contraint de partir se battre au Vietnam qui rentre dans sa ville natale pour se voir montrer la file de l’ANPE. Le fier rêve américain est bien loin... Des années plus tard, Springsteen admettra dans des interviews s’être sans doute trompé sur l’orchestration de ce morceau. Conçu au départ comme une balade acoustique, il l’avait transformé pour l’album éponyme en rock FM musclé. Du coup, la fameuse adéquation du fond et de la forme s’en est trouvée atteinte, et Springsteen reprend désormais la chanson en concert comme un vieux blues dont il a supprimé le refrain. Ce moment de la carrière du " boss " (le patron, comme il déteste qu’on l’appelle, ce que tout le monde fait néanmoins) est emblématique de son parcours de héros qui incarne l’Amérique tout en s’y opposant.
Bruce Springsteen a débuté sa carrière dans le New Jersey, son État natal qui est à la ville de New York ce que Billancourt est à Paris, le lieu où vivent et triment les cols bleus de l’Amérique immigrée depuis une, deux, trois ou quatre générations. Ses parents, d’origine hollando-italienne, ne dérogeaient pas à la règle, et de voir leur fiston gratter sa guitare et se laisser pousser les cheveux ne facilita pas les relations entre Bruce et son père. À la fin des années soixante, Springsteen écume dès l’âge de quinze ans les scènes locales du bord de mer en compagnie de différents groupes et passe des heures enfermé dans sa chambre à composer des chansons. Début des années soixante-dix, Hendrix est mort, tout comme Jim Morrison et Janis Joplin, les Beatles ne sont plus. Ne reste que Dylan, dont tout le monde attend la mort de toute façon, et Elvis que tout le monde regarde s’empâter entre deux passements de jambes inspirés. Alors Bruce s’identifie à leurs jours de gloire passés, forcément. En 1972, le frêle gamin du New Jersey décroche une audition à New York avec le légendaire John Hammond, l’homme qui avait signé le premier contrat de Bob Dylan. Bruce débarque avec sa guitare dans un étui d’emprunt, et quatre chansons plus tard, il sait qu’il a décroché un job : chanteur. Un an plus tard, il enregistre deux disques qui sortent la même année. Des textes fleuves - pour la plupart écrits avant que la musique ne soit composée " dans un souci poétique " -, des envolées musicales où se mélangent rock, folk, rhythm n’ blues et soul. Les albums se vendent mal mais la critique repère ce jeune homme ébouriffé qui se cache derrière une barbe effilochée. L’un d’entre eux, Jon Landau, écrit, lyrique : " J’ai vu le futur du rock’n’roll et son nom est Bruce Springsteen. "
Avec ce genre de compliments et sa qualification perpétuelle de nouveau Dylan, il est bon pour la retraite artistique. Heureusement, le bonhomme n’en fait qu’à sa tête, travaille d’arrache-pied et sort en 1975 l’album Born to Run, une espèce de coup de pied dans la fourmilière. Les personnages de ses chansons sont les mêmes, leurs lieux d’errance aussi, mais l’écriture s’est ramassée, devenant plus cinématographique et moins amphigourique, et la musique explose littéralement. En allant puiser aux sources des grands magiciens du son (les Beach Boys via Phil Spector et Chuck Berry), Springsteen trouve sa sonorité en même temps que son groupe définitif, l’E Street Band, avec qui il partage la couverture pour la seule fois de sa carrière. Cet assemblage de musiciens rencontrés durant l’époque où il écumait les bars fait irrésistiblement penser à une locomotive que rien n’arrête, capable de filer droit à pleine vapeur tout en négociant les virages les plus relevés. Pourtant, chacun des membres pris individuellement ne casserait pas trois cordes de guitares, mais réunis ensemble derrière leur boss, ils deviennent tout simplement le meilleur groupe de rock du monde, titre qu’ils doivent partager avec une autre formation médiocre en solo et sublime en quartet, le Crazy Horse de Neil Young. Un mois après la sortie du disque, Springsteen se retrouve la même semaine en couverture des plus grands magazines américains, Time et Newsweek, le genre d’honneur généralement réservé au président des États-Unis ou aux célébrités mortes. Bruce n’est ni l’un ni l’autre, simplement un " musicien qui écrit sur la vie des gens simples en espérant qu’ils s’y reconnaîtront ". Bruce devient une star. Springsteen chante contre le nucléaire, raconte dans ses concerts pourquoi il a tout fait pour ne pas partir combattre au Vietnam et comment il a passé sa jeunesse à se battre avec son père. Pas vraiment l’Américain moyen, mais l’Amérique s’identifie quand même. Un député du New Jersey propose que la chanson Born to Run devienne l’hymne de l’État. Encore un qui n’a pas compris les paroles de ce morceau effectivement consacré au New Jersey mais qui dit en substance : " Tirez-vous en ! "
Springsteen vieillit, voyage à travers les États-Unis en multipliant les tournées dont chacun des concerts ne dure pas moins de trois heures, il s’assombrit. Il sort trois albums de 1978 à 1982 qui vont vers plus de noirceur et de mélancolie. Les personnages de ses chansons se marient de force ou divorcent, leurs cavalcades sur les autoroutes ne mènent nulle part, les chômeurs s’enfoncent dans le désespoir. Springsteen plonge vers le dépouillement en enregistrant l’album Nebraska tout seul dans sa cuisine avec sa guitare, son harmonica et un magnéto sur un coin de table. Le rocker débordant d’énergie se veut baladin country, sauf que ses histoires dressent un sale portrait de l’Amérique. Songeant peut-être qu’il a trop tiré sur la corde, ou tout simplement parce qu’il a envie d’autre chose, Bruce fait de la musculation et sort Born in the USA, avec un bataillon de synthétiseurs et de chours. Tout le monde y voit la consécration des années Reagan, alors que les textes ne dévient pas vraiment de leur veine mélancolique. Le disque se vend par millions et Springsteen devient une superstar. Il rejoint les Sting, U2 et Madonna au panthéon des icônes MTV. Plus personne ne se donne la peine d’écouter ses paroles, seul le tempo suffit.
En 1985, il sort un quintuple album live rétrospectif de dix ans de carrière, histoire de damer le pion aux innombrables pirates qui circulent presque officiellement et qui font de Springsteen l’artiste le plus " bootleggué " au monde. Puis il met fin au E Street Band, se marie avec une actrice et met le cap sur Los Angeles. Il abandonne la chronique des désillusions du rêve américain pour se focaliser sur la vie de couple et les déchirements amoureux. Ses trois albums suivants laissent à penser que l’artiste a perdu sa fougue, sa foi et une partie de son talent. Il est toutefois encore capable de fulgurances occasionnelles pour des chansons de films (Philadelphia, Dead Man Walking), pour lesquelles il transforme son style, avec des rythmiques hip-hop et des nappes de synthétiseurs, tout en se replongeant dans la chronique sociale. En 1995, il surprend son monde en faisant paraître un nouvel album acoustique, placé sous le patronage de Tom Joad, le héros des Raisins de la colère, l’ouvre de John Steinbeck sur la grande dépression des années trente. Il se replonge dans le monde des ouvriers licenciés, des immigrés clandestins, des pêcheurs victimes de la concurrence. À la fois retour aux sources et nouveau départ, ce disque, malgré de faibles ventes, replace Springsteen dans le cour de ceux qui aiment son talent de " reporter social ". Seul bémol : ses chansons s’inspirent non pas de son vécu, mais d’articles de presse, de livres ou de films. Il chante admirablement l’Amérique des largués de troisième classe, mais son inspiration est de seconde main. Il se défend en disant que seule la véracité de la description compte, mais on ne peut s’empêcher de penser qu’il a atteint sa plus grosse contradiction. On perçoit aussi de plus en plus au travers de ses paroles le fait que Springsteen est un intellectuel, alors qu’il a toujours voulu se faire passer pour le gars d’à-côté. Désormais, Springsteen mène son bout de chemin sans se soucier d’autrui : il reforme l’E Street Band pour se faire plaisir, il sort un quadruple album de chansons inédites, il fait des tournées tout seul avec sa guitare quand ça lui chante. Il n’a plus rien à prouver, il sait que l’Amérique et une partie de son public ne le comprennent pas, ou plus. En fait, on le soupçonne de ne rêver que d’une chose aujourd’hui : partir avec sa guitare sur le dos pour sillonner les routes des États-Unis, Kerouac et Miller dans la poche, Woody Guthrie dans la tête. Ou alors c’est un rêve de fan...
Thomas Cantaloube
Someday girl
I don't know when
We're gonna get to that place
Where we really want to go
And we'll walk in the sun
But till then
Tramps like us
Baby we were born to run!