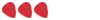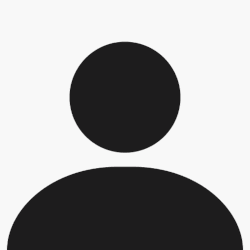Ben.oît a écrit :
"Critiqueur social" n'est pas gênant, j'aime beaucoup lire des avis de tous bords, c'est surtout "Condescendant" et "chiant" qui ne me donne pas envie de revenir sur ce sujet.
Pourtant les deux intervenants semblent connaitre quelques bouquins intéressants qu’il serait bon de nous faire partager, mais c’est fait de façon assez condescendante et donc pour moi, très chiante.
Puisqu’on en est à parler de livres, parlons du devenir de la lecture, en essayant de ne pas être trop condescendant, tout en étant très chiant quand même. D’après des estimations déjà anciennes, le vocabulaire et la compréhension grammaticale d’une large majorité d’Américains ne progresseraient plus au-delà d’un âge moyen de douze ou treize ans (Et quelles années ! Passées à quoi !) Ainsi beaucoup d’entre eux auraient le plus grand mal à comprendre une proposition subordonnée. En France aussi, nous sommes passés de l’ancien analphabétisme (incompatible avec la participation au fonctionnement d’une économie moderne), à l’analphabétisme de l’ignorance augmentée. Ce nouvel analphabétisme ressemble à l’ancien par certains traits : perte de l’orthographe, appauvrissement extrême du vocabulaire et de la syntaxe (cf. Jaime Semprun,
Défense et illustration de la novlangue française). Pourtant le langage parlé est dans ce cas également frappé, et il s’agit donc d’une décomposition du langage, à travers laquelle s’abolit cette fameuse distance entre le français parlé et le français écrit, à propos de laquelle on a proféré tant de bêtises, et à partir de laquelle quelques écrivains (Céline, Queneau, et la suite) se sont facilement fabriqué une douteuse originalité stylistique. La richesse du français parlé, depuis les divers argots jusqu’au simple langage populaire, s’est abîmée dans l’épouvantable melting pot des jargons journalistiques, technocratiques, publicitaires, etc. On voit là, comme on peut les voir également dans la disparition de la chanson populaire, les effets de la perte de toute autonomie collective par rapport à la marchandise et à l’État. Les termes pseudo-argotiques lancés chaque saison, loin d’exprimer une rupture de ban avec la norme sociale, proclament servilement la fausse complicité dans la conformité, dans la familiarité avec la marchandise.
C’est à l’intérieur de la perte générale du jugement, et donc du langage, du vocabulaire, que s’inscrit le sort particulier de la lecture. Quoiqu’il sache lire au sens de l’Unesco, la barrière qui sépare le spectateur, saturé d’images, de bruits et de mensonges, des écrits importants, de l’humour de Swift par exemple, est tout aussi réelle que la stricte incapacité à déchiffrer un texte. Le livre a été le principal instrument matériel de l’instauration d’une culture profane. D’abord enfermé dans les monastères, puis multiplié dans les bibliothèques universitaires, le livre, quand il se répand dans le monde grâce à l’imprimerie, rend accessible à chacun la mémoire de ce qu’on fait, ressenti et pensé les hommes qui l’ont précédé : la conscience historique moderne qui se donne pour horizon les intérêts universels de l’humanité est en ceci fille du livre. Le livre a en tout cas été une arme à longue portée dans les luttes historiques de l’époque moderne et, sur la durée, on peut dire qu’il a surtout servi aux forces de l’émancipation. En effet, maniable et reproductible à volonté, le livre donne à l’écrit la plus grande publicité, une véritable existence collective tout en généralisant la liberté de la réflexion individuelle, du jugement sur pièce de la pensée, précédemment réservée à une infime minorité.
On peut dire rapidement de la pensée déposée dans un écrit qu'elle a partie liée avec le temps. Elle doit admettre que sa vérité est en avant d'elle, dans une vérification possible. Elle se comprend elle-même dans la continuité d'une histoire de la conscience, comme mémoire et comme projet. Ceci vaut pour tout écrit de quelque valeur, quel que soit le genre.
En revanche ce qui caractérise la littérature abrutissante (j‘en ai déjà touché un mot il y a quelques semaines), au-delà de tout critère esthétique, c'est précisément qu'e consommée pour
distraire une fraction du temps, elle reste
lettre morte, sans projet, sans poésie parce que sans
temps devant elle. Il ne s'agit plus alors que de plus ou moins grande virtuosité dans l'usage d'une convention figée, et cela peut aller des romans à l'eau de rose style Harlequin aux raffinements à la Perec.
Le livre, comme « manière spéciale de vivre »(Flaubert), peut aussi être, pour celui qui le lit comme pour celui qui l'écrit, une manière de ne pas vivre, de se résigner, comme le montrent abondamment littérateurs et intellectuels : ou plutôt comme ils le montraient, car les spécialistes de l'écrit sont aujourd'hui bien en peine de concurrencer les substituts artificiels à la vie.
Bref, le livre n’est qu’un moyen, mais il a été le moyen d’une société dont la culture représentait la dimension historique partiellement consciente : mais c’est encore trop pour le rêve dominant d’une glaciation définitive gérée par les mémoires automatiques des machines et de leurs logiciels. Avec la solution finale du problème du langage, la vie des mots cède la place à la circulation des signaux. Dans le temps schizophrénique occupé par les loisirs programmés, succession d’instants émiettés sans résultat ni processus, se perd la capacité à lire, à habiter la mémoire déposée dans un livre et à l’accorder à son temps propre.
Ainsi un produit de l’édition moderne, qui n’est pas fait pour être lu, rencontre-t-il chez ses acheteurs une incapacité à lire qui le justifie pleinement. Et, circulairement, la disparition du temps de la lecture dans la vie quotidienne du consommateur, renforce la tendance à la liquidation de la mémoire écrite.