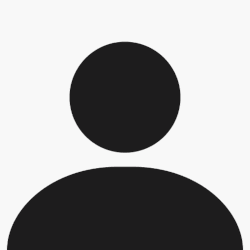jeroveh a écrit :
Un texte éclairant d'Anselm Jappe paru dans la revue Lignes (et réédité dans
Crédit à mort) à propos de la violence policière et de la violence insurrectionnelle dans le contexte actuel d'effondrement politique, économique et social :
Quel est le visage de la violence en France ? Pour quelqu’un qui fréquente habituellement différents pays européens, la première image de violence, dès qu’on arrive à la gare ou à l’aéroport en France, c’est la police. Jamais je n’ai vu autant de policiers qu’actuellement en France, surtout à Paris. Même pas en Turquie à l’époque de la dictature militaire. On pourrait croire qu’un coup d’État est en train d’avoir lieu, ou qu’on se trouve dans un pays occupé. En Italie ou en Allemagne, rien de comparable en ce moment. Et quels policiers : un air de brutalité et d’arrogance qui défie toute comparaison. Dès qu’on fait la moindre objection – par exemple face à des contrôles d’identité et des fouilles de bagages avant l’accès au train, du jamais vu – on sent qu’on frôle l’arrestation, le matraquage et finalement l’accusation d’ « outrage à agent de la force publique ». On peine à s’imaginer à quoi ça peut ressembler si l’on a la peau plus foncée, ou si l’on ne peut pas sortir les bons papiers.
On tremble d’indignation en lisant que des policiers rentrent dans les collèges, sous le prétexte de chercher de la drogue, où ils terrorisent les enfants avec des chiens et dénoncent les professeurs qui tentent de protéger leurs élèves. Ou lorsqu’on apprend les arrestations brutales de journalistes accusés de simple « délit d’opinion ». Pour ne pas parler des conditions dans lesquelles s’effectuent les expulsions de « sans-papiers » et du fait que le ministère a fixé à l’avance le nombre de malheurs à créer, de destins à briser, à la manière des chiffres de production et d’arrestations établis par décret en Union soviétique dans les beaux jours (pour la police).
Ce qui ressort surtout, c’est l’intention d’humilier, mise en pratique avec une application presque scientifique. Plusieurs fois, des journalistes ont démontré l’inutilité des contrôles dans les aéroports, en s’embarquant sans problèmes sur un avion avec des couteaux ou les composants d’une bombe. Mais dans les aéroports on continue à fouiller les bébés et à faire boire aux parents leurs biberons ; et on oblige tout le monde à retirer sa ceinture. Peut-être ai-je l’imagination trop vive ; cela me rappelle à chaque fois le procès des généraux prussiens qui avaient attenté à la vie de Hitler le 20 juillet 1944 : pour humilier le plus possible ces anciens aristocrates, les nazis leur avaient donné, aux audiences, des vêtements bien trop larges, sans ceintures, et se délectaient de les voir tout le temps tenir leur pantalon avec les mains…
Pas besoin de lire des brûlots révolutionnaires pour apprendre les méfaits de la police et de la justice,
Le Monde suffit. L’inquiétude se répand, même dans la bourgeoisie libérale. Pourquoi y a-t-il alors si peu d’initiatives pour la défense des « libertés civiles » ? On assiste à de grandes manifestations pour le « pouvoir d’achat » ou contre la suppression des postes dans l’enseignement, mais jamais contre les caméras de surveillance vidéo, et encore moins contre le passeport biométrique ou le « navigo » dans le métro parisien qui permet de suivre chaque bête à la trace.
Cette toute-puissance de la police et d’une justice au service du gouvernement est une tendance universelle (il suffit de rappeler que la Grande-Bretagne, la patrie de la démocratie bourgeoise, a pratiquement aboli l’
Habeas corpus qui prévoit qu’une personne arrêtée doit être présenté dans les trois jours devant un juge et dont l’introduction, en 1679, est considérée habituellement comme le début de l’État de droit et de la liberté de l’individu face à l’arbitraire de l’État – une abolition qui sonne comme la clôture symbolique d’une longue phase historique). La tendance à l’État policier semble pourtant plus développée en France que dans toute autre « vieille démocratie ». On y est allé très loin dans l’effacement des frontières entre terrorisme, violence collective, sabotage et illégalité. Cette criminalisation de toutes les formes de contestation qui ne sont pas strictement « légales » est un événement majeur de notre temps. On a vu dernièrement qu’écrire des tags ou retarder des trains peut passer pour du « terrorisme ». Ou qu’on peut se retrouver au tribunal pour avoir protesté, verbalement, contre une « reconduite à la frontière » dans un avion. Les faits sont trop connus pour qu’on les répète ici. La « démocratie » est plus que jamais purement formelle et se limite à choisir périodiquement entre les représentants des différentes nuances de la même gestion (et même ce reste de choix est truqué). Toute opposition à la politique des instances élues qui va au-delà d’une pétition ou d’une lettre au député local est par définition « anti-démocratique ». En d’autres mots, tout ce qui pourrait avoir la moindre efficacité est interdit, même ce qui était encore permis il n’y a pas longtemps. Ainsi, en Italie le gouvernement vient de restreindre fortement le droit de grève dans les services publics et d’introduire de grosses amendes pour les sit-in sur les voies de circulation ; les étudiants qui mènent encore des protestations se sont vus qualifiés par un ministre de « guérilleros ».
Dans cette conception de la vie publique, toute initiative revient exclusivement à l’État, aux institutions, aux autorités. D’ailleurs, cette monopolisation étatique de toutes les formes de conflictualité se retrouve également dans la vie quotidienne. Désormais, pour toute offense, pour tout différend, on recourt à la justice. La lutte contre le « harcèlement » a beaucoup contribué à retirer aux individus la capacité de réagir personnellement aux déplaisirs causés par autrui et les pousse toujours plus vers une dépendance totale. On ne répond plus à une injure avec une autre injure, ou à la limite avec une claque, mais en remplissant un formulaire au commissariat. On prétend ainsi, surtout à gauche, défendre les plus faibles, surtout les femmes ; en vérité, on les rend plus faibles et dépendants que jamais. On nous exproprie des formes les plus élémentaires de réaction personnelle.
En même temps, on sait qu’en Irak, les Américains laissent le sale boulot essentiellement à des compagnies privées – les contractors – composées de mercenaires venus du monde entier. Le nombre des « agents de sécurité » privés augmente partout. En Italie, le gouvernement Berlusconi, qui base son consensus largement sur le racisme envers les immigrés, identifiés in toto à la criminalité, a autorisé par décret la formation de « rondes » de « citoyens » pour contrôler le territoire. Il a même permis leur financement par des privés, ce qui pourrait amener, en perspective, à des « escadrons de la mort » comme en Amérique latine, payés par des commerçants désireux qu’on « nettoie » leur quartier.
Le renforcement du monopole de la violence par l’État et sa cession aux privés ne sont pourtant pas en contradiction : la violence est le noyau de l’État, et elle l’a toujours été.
En temps de crise, l’État se retransforme en ce qu’il était historiquement à ses débuts : une bande armée. Les milices deviennent des polices « régulières », dans de nombreuses régions du monde, et les polices deviennent des milices et des bandes armées. Derrière toute la rhétorique sur l’État et sur son rôle civilisateur, il y a toujours, en dernière analyse, quelqu’un qui fracasse le crâne à un autre homme, ou qui a au moins la possibilité de le faire. Les fonctions et le fonctionnement de l’État ont varié énormément dans l’histoire, mais l’exercice de la violence est son dénominateur commun. L’État peut s’occuper du bien-être de ses citoyens, ou pas ; il peut dispenser un enseignement, ou pas ; il peut créer et maintenir des infrastructures, ou pas ; il peut régler la vie économique, ou pas ; il peut ouvertement être au service d’un petit groupe, ou d’un seul individu, ou au contraire affirmer servir l’intérêt commun : rien de cela ne lui est essentiel. Mais un État sans hommes armés qui le défendent à l’extérieur et qui sauvegardent l’« ordre » à l’intérieur ne serait pas un État. Sur ce point, on peut donner raison à Hobbes, ou à Carl Schmitt : la possibilité d’administrer la mort reste le pivot de toute construction étatique.
En temps de crise, l'État n'a plus rien à offrir à ses citoyens que la « protection », et il a donc tout intérêt à perpétuer l'insécurité qui crée la demande de protection. Il peut se priver de toutes ses fonctions, mais pas du maintien de l'ordre. C'était déjà l'avis du prophète du néolibéralisme, Milton Friedman : l'État doit tout laisser à l'initiative privée, sauf la sécurité (il est vrai que son fils David, qui a voulu encore en rajouter, a proposé de privatiser même l'exercice de la justice. Mais là, c'était trop, même pour les libéraux
hardcore).
La suite du texte d'Anselm Jappe est ici :
http://palim-psao.over-blog.fr(...).html
excellent!! voilà le genre de texte qui doit donner la migraine à tout le spectre politique, de bayrou au fn, de besancenot à l'ump clientéliste en passant par le pc, le ps et les écolos!