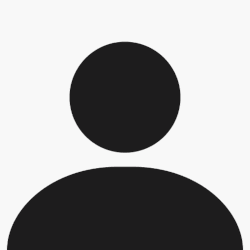« J’ai bugué »
Voilà un texte sur le sujet afin d'en approfondir la portée, et qui pourra peut-être être utile à certains... J’espère que c’est pas trop court ! En fait, ce ne sont que dix pages d’un livre qui en compte 90, mais qui en disent plus long que la plupart des gros livres publiés par les pseudo-penseurs à la mode. Le titre de ce livre est
Défense et illustration de la novlangue française.
Préface
Tout progrès individuel ou national étant sur-le-champ annoncé par un progrès rigoureusement proportionnel dans le langage, notre époque devait nécessairement s’illustrer par de remarquables créations linguistiques. Ces innovations ont jusqu’alors été mal jugées, à partir de critères littéraires ou esthétiques arbitraires. Un linguiste de la vieille école historique, qui raisonnait plus sainement puisqu’il considérait qu’en cette matière « le progrès consiste en ce que la langue s’adapte le mieux aux besoins des sujets parlants », s’était demandé au début du XXème siècle ce qu’il adviendrait du français dans l’hypothèse où se produirait « un cataclysme politique ou social qui renverse les barrières existant aujourd’hui entre les groupements humains, qui confonde dans une même tourmente les représentants de classes, de nationalités, de races différentes, qui anéantisse même notre civilisation séculaire pour faire la place nette à une civilisation nouvelle établie sur d’autres bases ». Il m’a semblé que près d’un siècle plus tard, alors qu’après tant de bouleversements on peut en tout cas constater l’anéantissement de ce que Vendryes appelait « notre civilisation séculaire », il devenait possible d’en discerner les conséquences pour la langue.
Chapitre VIII
Que la novlangue s’impose quand les machines communiquent
Le philologue Klemperer, qui eut l’occasion d’observer dans l’Allemagne des années trente la tentative d’imposer une langue nouvelle, y notait la « profusion de tournures appartenant au domaine technique, la foule de mots mécanisants ». Pour illustrer cette « tendance à la mécanisation et à l’automatisation », aboutissant à une « mécanisation flagrante de la personne elle-même », il donnait comme création caractéristique le verbe
gleichschalten, emprunté au vocabulaire de l’électromécanique, et dont il disait qu’il faisait « entendre le déclic du bouton sur lequel on appuie pour donner à des êtres humains une attitude, un mouvement, uniforme et automatiques ». Ce verbe, qui signifie littéralement « synchroniser », est habituellement traduit par « mettre au pas », mais la richesse de la novlangue française permettrait, me semble-t-il, de lui trouver un meilleur équivalent : on pourrait par exemple utiliser « mettre en phase », ou peut-être « formater », selon les cas. Quoi qu’il en soit, il existe certainement un terme approprié, que l’usage imposera s’il ne l’a pas déjà fait.
Ce ne sont en effet pas les termes et les tournures venus du domaine technique, en particulier informatique, qui manquent dans le nouvel idiome en formation. Peut-on pour autant risquer un parallèle avec la langue du IIIème Reich étudiée par Klemperer ? Assurément pas, puisque celui-ci remarquait justement qu’il ne s’agissait alors que d’un « empiètement de tournures techniques sur des domaines non techniques », domaines qui étaient encore si nombreux, vastes et divers qu’y imposer in langage technicisé exigeait d’exercer la violence la plus terroriste. Les résultats ainsi obtenus à force de contrainte policière ne pouvaient guère être durables, et les promoteurs de cette novlangue arbitraire et prématurée s’abusaient donc grandement quand ils proclamaient que la langue de l’époque précédente, qu’ils appelaient un « passé momifié », n’était « plus parlée ni comprise aujourd’hui ». En dépit de leurs fières déclarations sur la « clarté » et la « détermination » de leurs directives, leur manque d’assurance et de
technicité se trahissait d’ailleurs par le recours contradictoire à une phraséologie mythico-naturiste truffée de métaphores mettant l’accent sur ce qui germe et pousse spontanément, sans être forcé et perverti, « artificialisé », par l’intelligence : la « vérité organique », « centre mystérieux de l’âme du peuple et de la race », et tout ce autour de quoi flotte l’odeur entêtante du sang.
Rien de tel dans la novlangue française, où la profusion de termes techniques correspond très exactement à l’extension des domaines de la vie effectivement régis par la rationalité technique. Ainsi, quand y est évoqué l’
environnement, ce n’est plus sous la forme mystifiée d’une « nature », puissance obscure échappant aux lumières de l’intelligence et du calcul rationnel, mais, comme on l’a vu à propos d’
agroforesterie et de
biodiversité, en tant que stock de ressources à protéger et à gérer. L’actuelle technicisation de la langue peut d’autant moins être assimilée à celle maladroitement bricolée par les idéologues du IIIème Reich qu’elle n’est pas imposée autoritairement, mais répond à une
demande sociale authentique, relayée par toutes sortes d’experts dont
l’ouverture à l’Autre est le
métier. Une fois encore la presse du jour m’en donne opportunément un exemple. Un psychiatre expose en quoi Internet peut faire office de
thérapie comportementale, en aidant celui qui, atteint de
phobie sociale, se montre incapable de parler en société, à franchir le pas par
courriel, et donc à
mettre la machine en route, à
amorcer la relation et à
rôder ainsi ses sentiments. Ces trois tournures figurées empruntées au domaine mécanique sont immédiatement comprises de tous, elles n’appartiennent en rien à un jargon professionnel spécialisé, et par là encore la novlangue manifeste son caractère foncièrement démocratique : c’est d’un même mouvement que tout le monde parle comme les
psys et que les
psys parlent comme tout le monde.
Car chacun a été
rôdé par sa fréquentation quotidienne des machines, et a donc spontanément recours, pour décrire ce qu’on aurait appelé en archéolangue des opérations de l’esprit ou des états de conscience, à des images inspirées par le fonctionnement d’appareils électriques et surtout électroniques : on ne grave plus un souvenir dans sa mémoire mais
sur son disque dur, on est
branché sur toutes sortes de
réseaux, on
capte, on
percute, on
zappe, éventuellement on
pète un plomb ou encore
un câble, etc. Je l’ai déjà dit, mon propos n’est pas ici de dresser une nomenclature qui serait forcément incomplète. Le phénomène est de toute façon si évident que je peux laisser au lecteur le soin de compléter par de nouveaux exemples. J’en ajouterais cependant un dernier, parce que celui-là ne me vient pas de la presse et qu’il illustre bien ce dont je veux parler. Il consiste dans la formation d’un verbe à partir du terme anglo-américain
bug, verbe utilisé sous la forme active, et non plus seulement au participe passé, pour dire d’un programme informatique qu’il est
bugué. Un enfant qui apprend le piano et fait une fausse note dira ainsi très naturellement : « J'ai
bugué. » On voit ici à quel point les puristes méconnaissent les lois qui président à l'évolution de la langue, et en particulier la force de propagation des images fondées sur l'expérience commune, puisqu'ils en sont encore à proposer, pour sauver quelque chose de l'archéolangue, de remplacer
bugué par « vérolé » ou « infecté ».
C'est à de telles absurdités qu'aboutit inévitablement la volonté puriste de fixer la langue, d'entraver le libre jeu de l'imagination, qui n'a jamais cessé de transformer et d'enrichir le lexique en transposant des mots d'un ordre d'idées dans un autre. Le mot
bug lui-même, qui en anglais signifie au départ punaise, a dû faire un long chemin, que je ne retracerai pas ici, avant d'en arriver à désigner une sorte de vérole informatique. Puis il est passé en français, et enfin son sens a été élargi pour qu'il serve à désigner commodément et brièvement tout dysfonctionnement, qu'il soit le fait d'un ordinateur ou d'un homme : l'ordinateur, auquel nous avions prêté l'aptitude à être
convivial, nous a rendu celle à
buguer. Certes il y a là ce que les anciennes rhétoriques appelaient une catachrèse, un abus de langage, mais on ne pourrait prononcer ou écrire deux phrases de suite si l'on voulait ramener tous les mots à l'exacte portée qu'ils avaient à l'origine. Et quant à l'emprunt à une langue étrangère, Bréal en avait fort sensément dit, il y a plus d'un siècle, tout ce qu'il y a à en dire : « A toute époque, chez toutes les nations, il s'est trouvé des puristes pour protester contre ces emprunts. Mais ceux qui forment le langage, voulant avant tout être compris, et être compris aux moindres frais, s'inquiètent peu de la provenance des matériaux qu'ils mettent en œuvre. »
Il est bien sûr impossible de prévoir si cette tournure figurée, « j’ai
bugué », se répandra dans l’usage. Certaines images créées ainsi par rapprochement de deux objets ou de deux actes ont été adoptées parce qu’elles étaient justes, pittoresques, qu’elles comblaient une lacune dans le vocabulaire ou même seulement formulaient plus vite ce qu’il y avait à dire ; d’autres, au contraire, parce qu’elles ne répondaient à aucun besoin de ce genre ou qu’elles introduisaient une ambiguïté fâcheuse, n’ont pas « pris ». Quoi qu’il en soit, le procédé de formation mis en œuvre dans ce cas, consistant à utiliser un mot provenant d’un vocabulaire technique particulier pour en étendre la signification, est pour sa part irréprochable. Il est en effet, qu’on le considère en tant que simple élargissement ou plutôt en tant que métaphore, conforme à la nature même du langage et de son développement. Pour s’en convaincre, que l’on songe un instant aux innombrables termes abstraits qui, dans les diverses langues, ont pour origine un mot fourni par le vocabulaire spécial de ce que l’on appelait les « arts mécaniques ». C’est ainsi que le mot latin
ordo, qui nous a donné « ordre » et la longue série de ses significations jusqu’aux plus abstraites, vient lui-même de l’activité du tisserand et du verbe signifiant ourdir, disposer les fils de la chaîne pour exécuter un tissu. Il est donc tout naturel qu’aujourd’hui l’informatique, qui tisse plus que toute autre technique la trame de nos existences, soit la principale pourvoyeuse de mots formés selon ce procédé.
À cette question de la technicisation de la novlangue est liée celle de ses clichés. Ces formules toutes faites, nommées, selon le procédé que je viens d’évoquer, à l’aide du terme d’imprimerie désignant l’opération qui consiste à fondre un bloc d’après l’empreinte d’une page composée en caractères mobiles, sont donc des blocs de mots définitivement fixés et utilisables à l’infini, ce que la linguistique appelle plus savamment, sans concession au pittoresque, des
syntagmes figés. Leur fréquence dans les langages spéciaux forgés par les idéologies totalitaires, où ils servaient surtout de signes d’appartenance et de fidélité au parti ou au « mouvement », a fait appliquer à ceux-ci la dénomination de « langue de bois », évoquant la rigidité et la lourdeur. Cette expression est elle-même devenue un cliché, utilisé pour marquer, concurremment avec la formule
pensée unique, combien on se distingue pour sa part par la liberté de ses propos. Il n’a évidemment pas manqué d’intellectuels anxieux d’afficher leur hétérodoxie pour dénoncer dans la novlangue une nouvelle « langue de bois », comparable par sa rigidité et sa pauvreté à celle des totalitarismes du XXème siècle : leurs propagandes faisaient du langage un instrument, un levier, une machine, et ce trait se retrouverait dans le langage technicisé d’aujourd’hui. La répétition constante des mêmes clichés y manifesterait l’écrasement des individus par le conformisme.
Je ne répéterai pas ce que j’ai dit plus haut concernant la différence entre l’empiètement des termes techniques dont parlait Klemperer et les emprunts par lesquels la novlangue s’enrichit de nouvelles tournures. Le fait que l’idéal de rationalité technique ne soit pas imposé brutalement de l’extérieur, mais ait été intériorisé, intégré à l’existence de chacun, permet de comprendre également combien le statut des clichés diffère dans la novlangue de celui qu’ils avaient dans les anciennes « langues de bois ». Pour éclairer cette différence, on peut se référer à l’histoire des techniques, justement, et penser à tout ce qui sépare les premiers « calculateurs électroniques », énormes et poussifs, des ordinateurs domestiques d’aujourd’hui; ou bien les
panneaux lourds en béton armé, tels qu’ils furent fabriqués là où l’initiative de l’industrialisation du bâtiment appartint d’abord à l’État, de la souplesse d’utilisation du béton mis en œuvre directement sur le chantier, comme c’est maintenant le cas. Et pourtant, à un regard superficiel, il pourrait sembler qu’on ait toujours affaire aux mêmes choses, à des ordinateurs et à du béton.
Les clichés des langages totalitaires, comme ces
panneaux lourds si malaisés à transporter et à installer, supposaient une organisation centralisée, un pouvoir de décision unifié, une efficacité obtenue à force de simplification, de standardisation à outrance. Nous n’en sommes plus là. Quand les ordinateurs sont domestiques, la novlangue est pour ainsi dire
home-made. Nous avons vu plus haut combien elle était démocratique par sa destination, par sa conformité à la demande sociale, nous allons voir maintenant qu’elle l’est tout autant par son mode de production.
Les robinsonnades numériques qui nous sont habituellement proposées en guise de descriptions de la
société de l’information nous présentent un individu isolé faisant face à la luxuriance de la jungle virtuelle, à l’immensité de ses
possibles. Équipé de
moteurs de recherche, il se fraye un chemin, grimpe aux
arborescences,
surfe sur le
réseau de
chats en
chats. Inutile d’insister sur cette idylle
interactive, que nul ne peut ignorer.
Décrire les choses ainsi, en adoptant le point de vue de l’
internaute particulier, avide de satisfaire tel ou tel besoin ou curiosité, ou simplement de
dériver, permet aussi peu de comprendre le fonctionnement global du système informatique que ne le permettrait, dans le cas du capitalisme, une description adoptant le point de vue du consommateur particulier, et partant de son besoin d’acheter des chaussures ou du jambon. De même que le but premier du système marchand n’est assurément pas de satisfaire les besoins des consommateurs, mais de réaliser des profits, de même celui du système informatique mondial n’est pas d’informer ou de divertir les
cybercitoyens de la société programmée : il est de faire communiquer des machines avec d’autres machines, dans un langage de signaux binaires qui leur est propre.
Les machines tendaient en effet depuis longtemps à se relier entre elles directement, sans plus passer par le truchement de faillibles humains. Mais elles manquaient pour ce faire d’un langage commun, qui leur permît d’enregistrer des connaissances et de se les transmettre, d’acquérir donc une mémoire collective. C’est à ce besoin qu’a répondu l’informatisation. Quand, en 1872, Samuel Butler envisageait l’hypothèse que les machines de son époque fussent à celles de l’avenir ce que les premiers sauriens avaient été à l’homme, il ne pouvait encore qu’imaginer très confusément ce que serait un jour leur langage. Cependant il voyait bien dans les premiers vagissements poussés par les machines, dans les divers signaux, sonnettes ou sirènes d’alarme, par lesquels elles faisaient connaître leurs besoins à leurs conducteurs et mécaniciens, l’embryon d’un langage élaboré; exactement comme le cri, pour mettre en garde ou ordonner, a été la première forme de langage humain. Selon lui il était inévitable qu’à partir de là le peuple des machines n’en arrive un jour ou l’autre à accéder à un stade supérieur d’évolution, jusqu’à former une société organisée et, pensait-il même, à déclarer son indépendance.
Butler prenait soin de réfuter les arguments contraires à sa thèse; arguments qui se ramènent à peu près à dire que les machines, quels que soient leurs progrès, n’en restent pas moins à notre service, ne possèdent aucune espèce de libre arbitre et ne peuvent même pas se reproduire entre elles sans notre concours. À tout cela, il répondait à très bon escient que nous en jugerions plus sainement si, plutôt que de raisonner à partir de l’existence de chaque machine prise séparément, nous les considérions toutes ensemble comme une collectivité déjà organisée. Alors nous les verrions collaborer pour se reproduire et se perfectionner, et nous constaterions que si elles ont besoin des hommes pour se reproduire, c’est un peu à la façon dont beaucoup de plantes ont besoin d’insectes dans le même but. Mais tandis que les insectes remplissent cette fonction sans en avoir conscience, nous sommes quant à nous pleinement conscients, et même fiers, de servir ainsi le développement des machines.
Il convient d’ailleurs de noter l’argument selon lequel les machines ne se reproduisent pas entre elles sans notre concours peut désormais être exactement retourné : car même lorsque nous n’avons pas recours aux méthodes de
fécondation in vitro, nous ne nous reproduisons plus que grâce à l’assistance de diverses machines ou dispositifs techniques, à commencer par l’indispensable
échographie. Et les futurologues les plus confiants prévoient pour très bientôt des naissances
sécurisées dans des utérus artificiels entièrement pilotés par ordinateur.
Pour appuyer sa thèse, Butler relevait en outre deux faits qui sont aujourd’hui beaucoup plus marquants encore qu’à son époque. Le premier est que notre prétendu libre arbitre est un leurre, puisque nous ne saurions survivre plus de six semaines si nous étions brutalement privés des machines dont nous sommes devenus dépendants, tant moralement que matériellement. Le second, c’est qu’alors même qu’elles semblent être exclusivement à notre service, ce sont-elles qui nous dictent leurs conditions et nous imposent un mode de vie conforme à l’
optimisation de leur fonctionnement. E qui revient à dire qu’elles nous ont domestiqués, que nous les servons bien plus qu’elles ne nous servent. J’ajouterai que cette dernière affirmation n’est pas du tout infirmée par le fait que de nos jours les machines aient de moins en moins besoin de serviteurs humains, comme c’est le cas avec l’automation. En effet, cela prouve seulement qu’elles sont devenues plus indépendantes encore, qu’elles ont moins besoin de notre aide, bref qu’elles sont bel et bien sorties de l’enfance, comme l’avait annoncé Butler.
Tout cela parut assez osé, et aujourd’hui encore on se récriera en donnant tel ou tel exemple des services que nous rendent les machines, sans aucune contrepartie; et de citer, qui le
lave-vaisselle, qui le
téléphone mobile, etc. Mais c’est chaque fois en répétant l’erreur de jugement réfutée par Butler : en ne voyant qu’un objet isolé , tel que son utilité ponctuelle le fait passer pour bénin et de peu de conséquences. En revanche, dès qu’on le considère comme partie intégrante d’un ensemble, tout change. Et ainsi l’automobile, machine on ne peut plus triviale et presque archaïque, que chacun s'accorde à trouver bien utile et même indispensable à notre liberté de déplacement, devient tout autre chose si on la replace dans la société des machines, dans l'organisation générale dont elle est un simple élément, un rouage. On voit alors tout un système complexe, un gigantesque organisme composé de routes et d'autoroutes, de champs pétrolifères et d'oléoducs, de
stations-service et de
motels, de voyages organisés en cars et de grandes surfaces avec leurs parkings, d'
échangeurs et de
rocades, de chaînes de montage et de bureaux de « recherche et développement » ; mais aussi de surveillance policière, de signalisation, de codes, de réglementations, de normes, de soins chirurgicaux spécialisés, de « lutte contre la pollution », de montagnes de pneus usés, de batteries à recycler, de tôles à compresser. Et dans tout cela, tels des parasites vivant en symbiose avec l'organisme hôte, d'affectueux aphidiens chatouilleurs de machines, des hommes s'affairant pour les soigner, les entretenir, les alimenter, et les servant encore quand ils croient circuler à leur propre initiative, puisqu'il faut qu'elles soient ainsi usées et détruites au rythme prescrit pour que ne s'interrompe pas un instant leur reproduction, le fonctionnement du système général des machines.
Il me paraît inutile d’appliquer maintenant la même analyse à des machines beaucoup plus modernes, dont l’imbrication est si bien connue qu’elle a reçue le nom d’
interconnexion. Ce sont en effet pour la plupart de simples extensions du système nerveux des machines, des organes sensitifs, des sortes d’antennes ou de
terminaux qui servent à s’assurer que leurs porteurs humains se conforment docilement aux injonctions de la vie mécanique. Les exemples mêmes que ceux-ci donnent de l’usage qu’ils en ont illustrent bien cette fonction : on a besoin de ces machines pour mieux répondre aux exigences de toutes les autres. Et le fait que ce système nerveux, avec ses
satellites géostationnaires et son
réseau informatique, connaisse à chaque instant la position de chacune de ces terminaisons, ce qu’elles enregistrent, les informations qu’elles se transmettent, qu’il s’agisse de cartes de crédit ou de téléphones mobiles, suffit à prouver qu’il s’agit effectivement d’un seul et même organisme, même si sa morphologie ne correspond pas à l’idée que nous nous faisons d’un organisme vivant.
Pour finir de compléter la démonstration de Butler par des exemples contemporains, il me faut encore évoquer deux faits particulièrement significatifs. Tout d’abord que les hommes ont aujourd’hui si bien admis être au service des machines, de leur reproduction et de leur perfectionnement, qu’en toutes circonstances ils font passer les intérêts de celles-ci avant les leurs. Non seulement il n’est pas d’incommodité qu’ils ne soient prêts à endurer si elle se trouve justifiée à leurs yeux par des impératifs techniques, mais c’est jusqu’à leur simple survie qu’ils mettent tranquillement en péril pour ne gêner en rien le développement de la société des machines. En ce domaine, rien ne leur fait peur : le bouleversement du climat, la radioactivité, l’action imprévisible de molécules chimiques toujours plus nombreuses, etc., quels qu’en soient les effets reconnus sur leur santé, étant d’une manière ou d’une autre nécessaires à la bonne marche du monde mécanisé, sont acceptés de bonne grâce. Et le prestige des machines n’en est pas affecté. La dévotion dont elles sont l’objet dégénère même chez certains en fanatisme : que le monde périsse, mais qu’elles règnent ! Pourtant cette foi inébranlable, selon laquelle tous les problèmes créés par la civilisation de la machine seront
solutionnés par un stade ultérieur de son développement, repose sur une constatation de notre infériorité qui ne manque en tout cas pas de lucidité. Cela fait un peu songer à un mot de la fin de l’Ancien Régime, celui de ce marquis, petit, laid et contrefait, qui en montrant les beaux laquais de sa maison disait : « Voyez comme nous les faisons et comme ils nous font. » Si l’on admet qu’ainsi que le notait en 1912 Carlo Michelstaedter, « chaque progrès de la technique abêtit la partie correspondante du corps de l’homme », on doit aussi admettre que respecter l’intelligence des machines n’est pas un acte de foi, mais une manifestation de réalisme. Butler remarquait déjà que « dès que la précision est nécessaire, l’homme court bien vite à la machine », et où est-elle plus nécessaire que dans la mesure des altérations subies par notre milieu naturel ?
Voilà qui m’amène tout naturellement au second fait que je voulais mentionner. À l’aide de leurs organes sensibles, de leurs
capteurs, les machines accumulent des
données, des
informations pertinentes, qu’elles se transmettent en quelque sorte par-dessus nos têtes, et auxquelles en tout cas nous n’avons accès que par leur truchement. Car ces données, qui concernent l’ensemble des conditions dans lesquelles se déroule désormais la vie terrestre, ne sont pas directement accessibles à nos sens trop grossiers. Dans le cas de la radioactivité artificielle et de son augmentation régulière, par exemple, seules des machines peuvent enregistrer exactement le résultat de l’activité d’autres machines, en l’occurrence les centrales nucléaires. Qu’est-ce qu’un homme sans compteur Geiger ni
badge dosimétrique, et auquel manque sa pastille d’iode lors d’une
urgence radiologique ? Mais c’est dans tous les domaines, du trafic aérien au circuit des virus, de l’absence d’ozone à la présence de dioxines, que la seule connaissance objective appartient aux machines. Il est donc logique et nécessaire qu’un langage mieux adapté à la transmission de telles connaissances précises prenne définitivement le pas sur le vieux langage humain, forgé à partir d’une expérience sensible si manifestement déficiente.
Cette longue digression était nécessaire, on le voit, pour éclairer sous son véritable jour le modèle que le
langage machine offre à la novlangue; et du même coup faire voir à quel point sont sans objet les regrets de ceux qui pleurent les richesses perdues de l’archéolangue, comme si elles avaient encore pour nous le moindre usage. Quand il faut mesurer en
gigaflops, unité correspondant à un milliard d’opérations par seconde, les performances des ordinateurs, parler ou écrire en archéolangue, c’est se traîner en patache sur une
autoroute de l’information. Mais cette désuétude des vieilles langues naturelles ne signifie pas seulement, comme il avait pu le sembler alors que la rationalisation commençait à nous soumettre aux rigueurs de la métrique et aux certitudes de la statistique, que la science positive acquise par les machines substitue son langage au nôtre, c’est-à-dire pénètre notre pensée de notions objectivement définies. En réalité les choses ne se passent pas aussi simplement, et il nous faut maintenant distinguer dans l’instauration de la novlangue deux tendances à l’œuvre , ou plutôt deux séries de conséquences apparemment opposées et pourtant dues à la seule et même action de rationalisation. C’est de ne pas avoir compris ces effets contradictoires dans leur unité profonde que se sont égarés la plupart des commentateurs.
La connaissance exacte des phénomènes et la vérité objective n’étant plus accessibles par les moyens limités qu’offre à la pensée le langage humain, celui-ci garde néanmoins pour fonction de traduire, à l’usage des populations, ce que disent les machines, c’est-à-dire les décisions prises par l’
intelligence artificielle. C’est pour remplir efficacement cette tâche qu’il devient toujours plus rigoureux, univoque, fonctionnel. Cependant l’automatisation de la pensée a simultanément un effet tout opposé, puisque le langage, dans tous ses autres usages
sociétaux, se trouve ainsi, pour la première fois dans l’histoire, affranchi des relations, toujours difficiles, qu’il entretenait avec le monde objectif. Jusque-là pesait sur lui la charge d’en rendre compte, ou du moins d’en dire quelque chose, ne serait-ce que des mensonges ou des fables. Le voilà allégé de ce fardeau, et par là de toute responsabilité quant à sa véracité. Il n’y a plus, comme l’avaient très justement fait remarquer en leur temps les philosophes
post-modernes, que des « jeux de langage ». La parole humaine peut enfin décoller de la réalité matérielle dans laquelle elle restait empêtrée; du même coup la voilà aussi délivrée du carcan de la logique, et donc de la syntaxe. Une liberté expressive aussi complète compense largement, pour la subjectivité moderne, les contraintes qu’impose par ailleurs la rationalisation.
Ce point est évidemment décisif pour unifier la compréhension des phénomènes apparemment si divers qui participent pourtant tous de l’essor de la novlangue. Les interactions entre les deux formes idiomatiques que je viens de distinguer n’en sont pas moins constantes. La novlangue pleinement
ludique, effervescente et créative, ne cesse d’emprunter termes et tournures à celle qui se plie aux contraintes techniques; et de son côté celle-ci, dans son travail de
communication en direction des populations, puise aussi par nécessité dans les inventions spontanées des « jeux de langage ». L’unité profonde de ces deux formes complémentaires de novlangue apparaît bien dans le fait qu’elles concourent à abolir les contraintes de l’ancienne syntaxe. On avait pu dire autrefois que l’archéolangue était l’œuvre commune des travailleurs manuels et des poètes. On pourrait dire aujourd’hui de la novlangue qu’elle est celle des informaticiens et des
créatifs de la culture ou de la publicité.
![]()
Jaime Semprun,
Défense et illustration de la novlangue française, Éditions de l'Encyclopédie des Nuisances, 2005.
TABLE DES MATIÈRES
Préface
I. Que la novlangue se constitue par la destruction de tout ce qui n'est pas elle.
II. S'il existe dans l'archéolangue une force de conservation propre à empêcher l'instauration de la novlangue.
III. En quoi la novlangue peut être dite la langue parfaite dont a si longtemps rêvé l'humanité.
IV. Des néologismes.
V. En quoi la novlangue parachève notre démocratie moderne.
VI. En quoi la novlangue réalise le programme des Lumières et de la Révolution française.
VII. Comment la linguistique scientifique a contribué à la formation de la novlangue.
VIII. Que la novlangue s'impose quand les machines communiquent.
IX. De la traduction.
X. S'il manque à la novlangue un poète qui sache l'illustrer comme Dante le fit pour la langue vulgaire de son temps.
XI. Réponse à diverses objections.
XII. Génie de la novlangue française.
XIII. Exhortation à délivrer le monde des archéolangues.