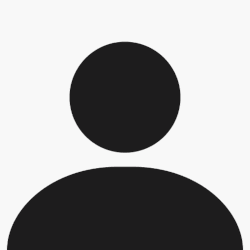
- jules_albert
-
Custom Cool utilisateur
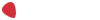
- #3870
- Publié par
jules_albert le 23 Juin 2014, 16:39
voilà le texte évoqué sur le topic "radio caroline". c'est une synthèse éclairante sur les vies et les morts du rock.
amorós va à l'essentiel (le livre compte une soixantaine de pages) mais n'oublie aucun des moments cruciaux de l'évolution du rock dans la société de classes et de consommation, l'extrême violence étatique qui s'est manifestée en amérique contre la jeunesse dans les années 60 et 70, et le rôle que le rock a parfois joué dans la contestation de cette société.
texte en anglais : https://libcom.org/library/roc(...)mor-s
ROCK POUR DÉBUTANTS
Frémis, balance, roule (Shake, rattle and roll)
Nous parlons de rock proprement dit en nous référant à un style musical déterminé créé par la sous-culture juvénile anglo-saxonne qui fit tache d'huile dans tous les pays où les conditions modernes de production et de consommation avaient dépassé un certain niveau qualitatif, c'est-à-dire, là où le capitalisme avait accouché d'une société de masse. Le phénomène prit forme d'abord aux États-Unis pendant la dernière après-guerre mondiale, le pays capitaliste le plus développé, pour passer ensuite en Angleterre, avant de retourner tel un boomerang au pays d'origine projetant son influence partout, meublant et changeant de diverses façons la vie des gens. Pour nous approcher du rock sans équivoques, il faudrait auparavant revoir les concepts de sous-culture, musique et jeunesse.
Le terme de "sous-culture" faisait référence aux conduites, valeurs, langages et symboles d'un environnement différencié - éthnique, géographique, sexuel ou religieux - à l'intérieur de la culture dominante, qui était et demeure, cela va de soi, la culture de la classe dominante. À partir des années soixante, une fois opérée depuis en haut la séparation entre la culture des élites, réservée aux dirigeants, et la culture des masses, conçue pour uniformiser les dirigés, leur abrutir le goût et brutaliser les sens - entre la high culture et la masscult, pour reprendre la terminologie de Dwight Macdonald - le terme exprimera plutôt des styles de vie consommatoires alternatifs, reflétés d'une certaine façon dans la musique qui au début s'appela "moderne" et ensuite "pop". Le mécanisme d'identification que produisait la sous-culture juvénile était éphémère car il était annulé par le caractère passager de la jeunesse. Dans cette étape volatile de la vie, sans responsabilité ni fonction économique, avec un prolétariat qui ne donnait pas de signe de lutte, la notion de sous-culture pouvait se confondre avec celle de mode, et celle de liberté, avec celle de look. Le rôle des médias, qui ne prêtaient guère d'attention aux sous-cultures traditionnelles, sera décisif dans la diffusion des modes pour la jeunesse. Dans ces modes se cachait une réalité plus inquiétante. Même si l'opposition au monde adulte apparaissait comme crise générationnelle, il s'agissait en fait d'une crise sociale non résolue. Ainsi, l'"éternelle crise de la jeunesse" finit par confluer avec d'autres types de crises - étudiante, du travail, raciale, politique - forgeant une authentique alternative éthique, artistique et sociale face aux valeurs et aux manières de la domination. Le rock fut sa bande son. On ne pouvait plus l'appeler sous-culture car elle ne cherchait pas à se faire une place dans la culture dominante contrairement aux styles précédents - par exemple, les bandes de quartier et de motards aux États-Unis, ou les teddy boys et les mods en Grande-Bretagne - car elle la subvertissait et tentait de la renverser : c'était quelque chose de pire, une véritable "contre-culture" qui n'était pas réservée uniquement aux jeunes.
D'autre part, la pop music a très peu à voir avec ce que l'on entend par musique. Bien que techniquement on puisse la considérer comme une organisation de sons dans le temps, il ne s'agissait pas d'un art mais plutôt d'un produit de l'industrie des loisirs, une marchandise du show business. Nous traduirons le terme par "musique légère" en opposition à la grande musique ou musique savante, qui alors commença à s'appeler "classique". Elle se caractérisait par la simplification et la standardisation; elle était faite pour accompagner la danse et servir de passe-temps et d'évasion. Les morceaux étaient courts, répétitifs et syncopés, prévisibles, sans prétentions esthétiques. Ils ne prétendaient pas révéler l'essence de la réalité dans son immédiateté comme se le propose l'art, mais animer et distraire. Son but était d'amuser, pas de défier l'ordre établi. Une musique pour passer du bon temps, se distraire, pour consommer et ne pas penser; musique qui servait de cheval de Troie de la raison marchande dans la vie quotidienne. Theodor W. Adorno affirme que "se divertir signifie être d'accord", et fondamentalement c'était cela : les musiques de danse représentaient, musicalement sublimés, les rythmes du travail et du mal-être quotidien. Elles promouvaient le conformisme plutôt que la rébellion. La culture de masse dont elles faisaient partie n'était pas vraiment une culture mais une industrie particulière qui s'enracinait dans la vie quotidienne à travers la communication de masse. Celui qui commandait dans les médias dominait dans cette culture qui, loin d'éclairer et d'exacerber les contradictions de la société capitaliste, les brouillaient et les estompaient, les rendant supportables. C'était la principale caractéristique du nouveau capitalisme basé sur la consommation, donc sur l'industrialisation du vécu. Même si la pop music n'était en rien l'expression de la situation sociale de la classe exploitée, elle put à un certain moment et dans des circonstances déterminées se transformer en véhicule des exigences de liberté manifestées par le secteur le moins docile de la population et le plus sensible à la crise : les jeunes. Elle parvint donc à être porteuse de vérité, qui pour Hegel est aussi beauté, et à manifester spontanément, de façon subjective et incomplète, faisant davantage appel aux sens - ou aux "bonnes vibrations" - qu'à la raison, l'esprit de la révolution sociale moderne.
En troisième lieu, la jeunesse, cette période entre l'enfance et la vie adulte, plus longue chez les fils de la bourgeoisie, très courte chez les fils de travailleurs, ne comportait rien de particulier dans le capitalisme classique. C'était une période d'initiation à la vie "responsable" où n'étaient admis que les principes et goûts de l'ordre établi. La découverte d'une jeunesse rebelle et conflictuelle qui questionnait les règles du monde des adultes fut traumatisant aussi bien pour la classe dominante que pour les classes résignées car elles étaient toutes patriarcales. Un moyen de communication comme le cinéma permit, pour un temps, à certains créateurs intellectuellement honnêtes de cesser de transmettre les messages du pouvoir pour traiter certains des aspects désagréables de la crue réalité. La Seconde Guerre mondiale fut suivie par la "guerre froide", une époque de tension politique exacerbée par la fabrication russe de la bombe atomique, l'arrivée au pouvoir de Mao Tsé-toung et le début de la guerre de Corée, événements qui provoquèrent aux États-Unis une vague de patriotisme et d'anticommunisme dont profita le sénateur Joseph McCarthy pour organiser une "chasse aux sorcières" qui atteignit de plein fouet le travail intellectuel et artistique. Les années du "maccarthysme", entre 1950 et 1956, furent néfastes pour les libertés formelles qui avaient régi la culture d'un État qui en devenant la première puissance mondiale se sentait menacé de l'intérieur. Dans ce climat suffocant, n'importe quel signe de dissidence était considéré comme communiste et réprimé vigoureusement. Au cinéma, la condition ouvrière était taboue; les syndicalistes étaient toujours représentés en mafieux, et les héros en délateurs, comme dans le film d'Elia Kazan, Sur les quais. La question raciale ne fut posée au grand public qu'en 1960 avec Le Sergent noir de John Ford et le roman de Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, adapté au cinéma en 1962. Néanmoins, le problème de la jeunesse, ignoré par les nouveaux inquisiteurs, accéda à la publicité sans grands obstacles. En 1953, apparaît dans les salles de cinéma L'Équipée sauvage de Laszlo Benedek qui traitait d'un fait véridique : l'invasion d'un village paisible par une bande de motards violents. Le contraste entre le respect de l'ordre de la part des villageois et la conduite irrespectueuse et sans normes des jeunes motards atteignait son apogée lorsqu'à la question de contre quoi ils se rebellaient, le protagoniste, incarné par Marlon Brando, répondait : "contre tout". Le nihilisme du message scandalisa les dirigeants; la firme Triumph protesta en raison de la mauvaise image conférée à ses motos et le gouvernement anglais ne permit pas la diffusion du film jusqu'en 1967 et uniquement dans des salles X ! En 1955, un deuxième film intitulé La Fureur de vivre (Rebel without a cause), dirigé par Nicholas Ray, donnerait une autre tournure au thème en le déplaçant des marges vers le centre de la société américaine : un jeune issu de la classe moyenne, interprété par James Dean, angoissé et insatisfait, perdu dans un milieu social qu'il ne voulait pas comprendre, le trouvant absurde, réagissait en se permettant n'importe quoi, sans motif apparent, uniquement "parce qu'il fallait bien faire quelque chose". L'image d'un adolescent violent et désemparé, convaincu qu'il n'y avait pas de futur qui en vaille la peine et qu'il ne restait plus qu'à vivre l'instant intensément comme si l'on allait mourir ce jour même, tournant le dos au monde adulte insensible à son mal-être, reflétait la décadence morale d'une société de classes qui au lieu de réponses offrait des dollars. L'ancienne génération, satisfaite et résignée, incapable de voir autre chose en dehors de soi-même, était devenue étrange pour la nouvelle. Le tableau fut complet avec Graine de violence de Richard Brooks, également sorti en 1955. L'action se déroulait dans un lycée de quartier où les jeunes issus de familles ouvrières, que l'on qualifierait aujourd'hui de "destructurés", attrapés dans un système d'enseignement qui ne leur était d'aucune utilité pour la vie pénible qui les attendait une fois qu'ils auraient atteint dix-huit ans, s'en prenaient aux professeurs et à l'école. L'indiscipline et la délinquance était la réponse à l'absence de perspectives et au destin réservé aux perdants. La musique diffère des deux films précédents. La bande son de L'Équipée sauvage était du jazz, celle de La Fureur de vivre fut écrite par un compositeur de musique dodécaphonique disciple de Schönberg. En revanche, dans Graine de violence, les élèves détruisent la collection de disques de jazz du professeur de mathématiques parce que cette musique ne leur dit rien. Ce qu'ils voulaient écouter c'était des chansons comme "Rock around the clock" de Bill Haley, que le film catapulta vers le succès. Un nouveau style était né, inconnu par les parents, mais qui faisait fureur chez les enfants, le rock and roll, signe d'une crise générationnelle profonde, ou mieux, d'une crise sociale sérieuse ressentie majoritairement par les jeunes.
Le blues de l'été n'a pas de remède (Ain't no cure for the summertime blues)
Une fois, Willie Dixon, musicien, compositeur et interprète de blues, a dit plus ou moins ceci : "Le blues fut l'arbre. Le reste ce sont les fruits." Il avait résumé en une phrase claire l'histoire du rock. Le rock and roll fut une affaire de Noirs. Il avait été créé en 1955 par un guitariste de rhythm and blues nommé Chuck Berry, lorsqu'il enregistra et eut du succès avec "Maybellene", adaptation d'une chanson country. Le rock naissait donc, comme chacun sait, de la fusion entre rhythm'n'blues et musique "paysanne", qui est le sens de "country". Elvis Presley avait enregistré une année auparavant "That's All Right (Mama)", mais apparemment personne n'y avait prêté attention. Quelles étaient les conditions qui avaient rendu possible son apparition ? En premier lieu, évidemment, la crise sociale et morale évoquée avant, manifeste principalement dans la jeunesse. En deuxième lieu, la musique d'une minorité discriminée, les Afro-Américains. En 1947, le journaliste Jerry Wexler avait baptisé sous le nom de rhythm'n'blues un nouveau style de boogie plus connu entre ses interprètes comme jump blues, et qui avait du succès dans les charts "de race" et avait la particularité d'attirer des acheteurs blancs. En 1951, une émission de radio pour la jeunesse de Cleveland transmit cette musique en l'appelant rock'n'roll, expression qui apparaissait souvent dans les paroles des blues accélérés. Les jeunes blancs avaient découverts tout un monde dans la musique noire. John Sinclair raconte dans son livre Guitar Army que les musiciens noirs furent les "chevaliers de la liberté" qui s'introduisirent dans les foyers blancs et séduisirent les rejetons en attaquant tous les tabous. Les fils se sentirent alors beaucoup plus proches des gens de couleur que leurs parents. Leur musique leur enseignait une nouvelle façon d'aimer et de se conduire, moins inhibée, plus fraternelle et, surtout, beaucoup plus érotique; elle leur montrait une sexualité ouverte et, chose intolérable, les incitait à fumer de l'herbe. Il y avait une vie au-delà du travail, loin du lycée et loin du sofa en face de la télévision. De fait, c'était la vie véritable, celle qui, dit philosophiquement, efface la distinction entre le sujet et l'objet. Le rock'n'roll était plus qu'un divertissement; c'était la musique du rejet; rejet de la morale hypocrite et de la culture officielle. En mettant l'accent sur le rythme plutôt que sur l'harmonie, elle faisait sentir d'autant mieux l'antagonisme entre la passion de vivre et l'ennui quotidien duquel les jeunes tentaient de sortir au moyen de la violence et de la transgression, mais sans parvenir à distinguer la situation de manière objective et rationnelle. C'était la musique du déracinement, de l'éveil, du mouvement, mais non de la catharsis révolutionnaire. L'identité juvénile qu'elle fournissait ne suffisait pas à provoquer un changement social, mais il allait timidement dans ce sens. Une contradiction empêchait la prise de conscience sociale. La jeunesse rebelle méprisait le travail, mais elle consommait : elle niait le comptoir et l'usine, mais pas la marchandise, ce qui fait qu'en cherchant une identité basée sur la musique, les habits ou la moto, elle se retrouvait simplement avec une image dont le contenu était sa valeur d'échange. La jeunesse était réellement un marché nouveau, en expansion. N'oublions pas que le rock'n'roll, son étendard musical, était un produit de l'industrie culturelle, des listes du hit-parade, des nouvelles compagnies de disque comme Modern, Atlantic, Chess ou Sun Records, du cinéma et de la radio; des dernières inventions de la technologie musicale, les disques de 45 tours et ceux de 33, les juke-box, les tourne-disques, les amplificateurs. C'était la troisième condition qui amena le rock dans les bars, les salons et les chambres à coucher, c'est-à-dire qui l'introduisit dans la vie quotidienne. Pour la première fois, il était possible d'écouter de la musique à n'importe quelle heure, à n'importe quelle place avec le son poussé à fond, une musique dont l'instrument principal était la guitare, et non le piano ou la voix. Pour Leni Sinclair, épouse de John, "le point d'inflexion de la civilisation occidentale fut atteint avec l'invention de la guitare électrique." Ce fut l'instrument du changement. Les premières Gibson et Fender devinrent des fétiches phalliques aptes pour composer des phrases musicales courtes ou riffs comme celles de "Manish boy", ce mémorable blues électrique enregistré en 1955 par Muddy Waters. La guitare rendait l'orchestre inutile; trois ou quatre musiciens tout au plus étaient suffisants pour l'accompagnement. Chuck Berry et Bo Diddley furent les premiers rockers à écrire leurs propres chansons pour la guitare étant donné qu'ils ne savaient pas jouer d'un autre instrument; ils servirent de modèle à leurs imitateurs blancs et ils leur fournirent des manifestes comme le très emblématique "Rock and roll music" et "Who do you love?" L'un d'eux, Buddy Holly, se fit accompagner par une guitare rythmique, une basse et une batterie, créant le quartet basique qui modèlera la plupart des groupes de pop rock des années soixante. D'autres artistes afro-américains comme Little Richard et Larry Williams, par exemple, montrèrent le chemin interdit de la sensualité avec "Lucille" et "Bonnie Moronie"; Elvis Presley fit le reste. Il avait l'avantage d'être blanc dans une société raciste qui tolérait difficilement le succès des Noirs, ce qui fait qu'Elvis fut déterminant dans l'ascension puis la chute du rock.
Le rock conservait une certaine autonomie créatrice qui le protégeait de la manipulation par le spectacle, mais cela ne dura pas. Le show business prit assez d'ampleur pour annuler son pouvoir négatif et l'obliger à maintenir une relation cordiale avec l'ordre établi. À partir de 1957, le rock'n'roll commença à se corrompre et à se transformer intégralement en montage. L'attitude rebelle fut remplacée par une identité grégaire qui satisfaisait un public obéissant au diktat de la mode à la place d'un sujet collectif autonome. Un grand nombre d'"idoles" adolescentes, bien coiffées, doucereuses et habillées avec correction entonnaient des couplets routiniers et sentimentaux qui, avec la mode des danses qui débuta avec le twist, dominèrent la scène jusqu'à l'apparition des Beatles. Le rock retournait dans le giron de la pop music commerciale, amusante et festive, occultant les inégalités sociales, l'angoisse et l'insatisfaction, modérant son langage de façon à le rendre agréable au goût dominant, le goût de la domination. Adorno a dit que "dans le capitalisme avancé, l'amusement est le prolongement du travail". Eh bien, de caillou dans le soulier de la culture de masse, le rock devenait rite d'initiation de la jeunesse dans le système capitaliste. Elvis revint changé du service militaire, transformé en caricature grotesque de lui-même. "Viva Las Vegas" n'était pas la même chose que "Heartbreak Hotel" ou "Jailhouse Rock". Les figures principales s'eclipsèrent; en février 1959, Buddy Holly et Richie Valens se tuèrent dans un accident d'avion; un an plus tard, Eddie Cochran se tue dans un accident de voiture. "Vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre !" avait dit Bogart il y a longtemps dans le film de Nicholas Ray, Les Ruelles du malheur. Le moment du rock était passé, il était littéralement mort, mais le défunt n'eut pas le temps de se reposer. La marche en avant du commerce eut la vertu de produire de nouvelles contradictions, et ainsi surgit du néant une nouvelle musique moins complaisante : une deuxième génération de jeunes trouva en elle une stimulation suffisante pour ne pas s'enfermer dans la simple répétition et continuer la bataille contre le vieux monde, mieux préparé pour affronter une crise plus profonde qui venait de l'époque précédente, mais aussi plus décomposé, plus irrationnel et plus inadmissible. En entrant dans les années soixante, le rock récupéra l'élément de liberté subjective perdue qui le situa de nouveau comme antithèse de la culture étatiste de masse.
Tu m'as vraiment eu (You really got me)
En ce qui concerne le rock, au début des sixties, la scène américaine comptait de nouveaux arrivants. D'une part, elle disposait d'une nouvelle vague d'arrangeurs, ingénieurs du son et compositeurs pop talentueux. D'autre part, le rhythm'n'blues s'était développé et avait donné naissance à la musique soul, dont une des versions édulcorées pour les Blancs, la musique du label de Detroit Tamla Motown, avait atteint une notoriété spectaculaire. Des chansons comme "Dancing in the streets" ou "Louie, Louie" devinrent indispensables dans les fêtes. Finalement, le folk ressurgit par l'intermédiaire de Woody Guthrie qui portait sur sa guitare l'inscription "cette machine tue des fascistes", et de Pete Seeger, interprète de "We shall overcome". Mêlé au radicalisme idéologique il donna lieu à la "chanson contestataire", idéale pour être interprêtée dans les marches pacifistes de l'époque en faveur des droits civils et contre la ségrégation raciale. Une longue liste d'auteurs-interprètes engagés se donnèrent rendez-vous dans les luttes sociales émergentes, pourtant c'est Bob Dylan, celui qui se prêta le moins à figurer politiquement, qui fut de loin le plus influent. Certaines de ses chansons, de "Blowin’ in the wind" à "Like a rolling stone", en passant par "The Times are a-changin’" et "It’s all over now, baby blue", devinrent des hymnes impérissables. Mais ce qui révolutionna vraiment la scène musicale fut son apparition orageuse au festival de Newport en 1965 avec une Stratocaster au lieu d'une guitare acoustique, accompagné par Mike Bloomfield et Al Kooper. Lorsqu'ils commencèrent à jouer les premiers accords de "Maggie's farm", cela sonnait comme un groupe de blues de Chicago. Sa musique tendait des ponts vers le rock de cette époque, ainsi que Jimi Hendrix, Manfred Mann, Julie Driscoll, The Band et en particulier The Byrds se chargèrent de proclamer, ou même vers la pop mielleuse des Walker Brothers, et portait l'esprit contestataire au-delà des cercles universitaires politisés amateurs de chansons folk. Ses chansons ne suscitaient pas l'engouement, mais elles surprenaient car elles allaient à l'encontre de toutes les conventions. Elles n'étaient pas faites pour être consommées mais pour qu'on prête attention à leur poésie et à leur message. La poésie de Dylan faisait le lien avec l'œuvre des écrivains de la génération beat comme Kerouac et Burroughs qui commençait à être connue. Le poète Allen Ginsberg servit de pont. Le folk éleva à son plus haut point la suprématie des paroles sur la musique et entraîna son auditoire vers la critique sociale. En rencontrant le rock, il le politisa, le transformant en outil de contestation.
La crise sociale en cours aux États-Unis restait larvée dans l'Europe en reconstruction, bien qu'elle donnait des signes de vie plus qu'évidents. En ce qui concerne le Royaume-Uni, les romans Absolute beginners de Colin McInnes, La Solitude du coureur de fond d'Alan Sillitoe et Baron's court, all chance de Terry Taylor sont une meilleure introduction aux sixties que n'importe quelle analyse sociologique. L'abondance de travail procura de l'argent aux jeunes des banlieues qui prenaient plaisir à le dépenser en vêtements, chaussures, motos et disques de blues, rhythm'n'blues, soul et rock'n'roll. La consommation, aidée par la télévision qui remplaçait la radio dans la communication de masse, s'étendit aux adolescents. Les musiciens noirs, encore discriminés dans leur pays, aimaient se rendre en Angleterre où ils étaient traités comme des génies tandis que les groupes musicaux les appuyaient et cherchaient à les imiter. Lors de sa mue, le rock avait laissé derrière lui ses racines rurales et était devenu entièrement urbain. En 1963, un de ces groupes, les joyeux et sympathiques Beatles se transforma du jour au lendemain en un phénomène de masse encore jamais vu auparavant que les médias appelèrent "beatlemania". Le précédent le plus proche, Elvis, était largement dépassé. Des singles aux paroles simplettes comme "Please, please me", "She loves you" ou "I want to hold your hand", tous sortis la même année, se vendirent en quantités inimaginables. L'année suivante, un autre groupe, pourvu d'une image débraillée et agressive, les Rolling Stones, jeta de l'huile sur le feu. Leur musique était plus dure, leurs paroles plus provocatrices, leur attitude davantage contraire aux bonnes manières. Si les Beatles représentaient le Ying du rock britannique, les Stones étaient le Yang. Les fans des premiers étaient des étudiants de secondaire, des teenagers accros à la mode, aux revues illustrées et aux émissions de télé, s'entassant par milliers au passage de leurs idoles et criant comme des possédés, ce qui stupéfiait vraiment le monde. Le spectacle de masse de gamins hystériques était trop tentant pour un média comme la télévision; un reportage sur ce sujet eut une grande répercussion aux États-Unis entraînant la visite des Beatles. En février 1964, leur participation au show d'Ed Sullivan fut regardée par 74 millions de personnes, soit la moitié du pays. La porte était désormais ouverte pour tous les groupes : d'abord les Rolling Stones, puis les Animals, les Yardbirds, les Kinks, les Who, les Hollies, Spencer Davis, Them et tant d'autres commencèrent à débarquer de l'autre côté de l'Atlantique révolutionnant la façon de jouer et de penser avec leur réinterprétation de la musique noire. Par ricochet, les portes britanniques et européennes s'étaient ouvertes pour des bluesmen géniaux pratiquement ignorés en Amérique du fait qu'ils étaient noirs, comme John Lee Hooker, Sonny Boy Williamson, Howlin’ Wolf, Muddy Waters, Willie Dixon, etc. Tous les groupes anglais considéraient un honneur de jouer aux côtés de maîtres aussi inégalables sans lesquels ils n'auraient littéralement jamais existés (les Rolling Stones qui devaient déjà leur nom à un thème de Muddy composé par Dixon, enregistrèrent leur deuxième ou troisième album chez Chess Records en 1964, et ils choisirent B.B. King - celui qui appelait toutes ses guitares "Lucille" - comme première partie de leur tournée américaine de 1969. Pendant ce temps, la musique pop britannique recevait un appui soutenu dû aux efforts du conservatisme des dirigeants des médias pour enrayer l'avancée du rock. Ceci entraîna l'apparition de radios pirates installées dans des bateaux qui émettaient du rock vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le meilleur exemple fut peut-être Radio Caroline, née en mars 1964. Trois ans après, dans un cadre assez différent, celui de "L'Été de l'amour" de San Francisco, Californie, apparaissait la première "radio libre", expérience vouée à une longue destinée.
Celle que l'on appela "Invasion britannique" déclencha une vague de groupes de "garage" qui pour la première fois avaient un public, et donc un marché. Le rock retournait à ses origines contestataires donnant une voix aux dissidents. Le succès d'une chanson comme "Satisfaction" n'a pas d'autre explication. Deux détails extramusicaux y contribuèrent. Vers l'Europe, la consommation de haschisch, plante médicinale qui favorisait la sociabilité; les Beatles fumèrent leur premier joint dans un hôtel de New York invités par Dylan. Vers l'Amérique, les cheveux longs; c'était ce qui scandalisait le plus les Américains partisans de l'ordre, jusqu'au point que les crignères seraient aux Blancs rebelles ce que la peau était aux Noirs, comme l'affirmait Jerry Rubin dans Do it ! Il y avait aussi un mauvais côté à tout cela; le rock avait poussé l'industrie culturelle vers de nouveaux sommets, générant de grands bénéfices et obtenant la reconnaissance des hiérarchies, symbolisée par l'octroi aux Beatles de la médaille de l'ordre de l'Empire britannique. En Europe, le rock ne s'affranchira jamais des impératifs commerciaux, mais il en était autrement aux États-Unis, place privilégiée de la révolte contre la société de consommation.
De nouveau en route (On the road again)
La marche vers Washington en août 1963 en faveur des droits des Noirs eut une telle répercussion qu'en moins d'un an, malgré l'assassinat du président Kennedy, une loi fut approuvée qui sur le papier mettait fin à la discrimination raciale. Cependant, la discrimination économique et sociale se poursuivait, protégée par la police blanche ainsi que le dénonçait le prédicateur Malcolm X, assassiné en février 1965, ou comme l'illustrèrent les émeutes de Watts en août de la même année, qui inspirèrent une chanson à Frank Zappa, "Troubles comin' every day", dans laquelle les non-Noirs étaient ulcérés d'être Blancs, chanson publiée ensuite dans l'album Freak out! des Mothers of Invention. Le besoin de se défendre conduisit à une radicalisation des Afro-Américains avec la création en octobre 1966 du Black Panther Party. La renaissance de l'orgueil noir et les nouvelles tactiques d'autodéfense influencèrent énormément les rebelles blancs des années soixante. D'autre part, la lutte en faveur des droits était renforcée par l'opposition à la guerre du Viêt Nam. En se rebellant contre la guerre, les jeunes protestaient contre la société qui l'avait provoquée, dénonçant les intérêts de classe qui se cachaient derrière elle. Les exigences d'égalité des races, paix, dialogue libre, dépénalisation des drogues ou de sexualité sans entraves combattaient une morale hypocrite conçue pour défendre l'inégalité, l'exploitation, l'autoritarisme politique et la famille patriarcale, bases du système. Si l'anarchisme et le marxisme dans leurs versions multiples ne suffisaient pas pour expliquer la révolte moderne, en revanche le bouddhisme zen préconisé par des automarginalisés sociaux non-violents que l'on commençait à appeler hippies - dans le sens de bohémiens, suiveurs de la tradition beat et lecteurs d'Alan Watts - offrait des manières de décrocher du système, intérieurement et extérieurement, tout en cherchant l'harmonie avec l'univers, manières qui ne collaient pas bien avec l'idée de révolution prônée par lesdites idéologies.
Cette contradiction pouvait se maintenir au moment de la montée de la crise, lorsque son aggravation était supposé conduire à des perspectives théorico-pratiques moins confuses et plus efficaces. L'expansion du maoïsme, le fanonisme et le guévarisme, produit de l'identification des contestataires avec les faux ennemis du système, à savoir, la Chine communiste, le régime de Castro et les mouvements de libération nationale, se chargerait d'empêcher que la confusion se dissipe. Des musiciens comme Country Joe tombèrent dans le piège, prenant ce nom en honneur au nom de guerre utilisé par Staline; ou comme Joan Baez qui rendit hommage à La Pasionaria, la pire vermine stalinienne; mais d'autres surent les éviter, par exemple, l'ironique Frank Zappa qui se référait aux gauchistes et aux droitistes comme des gens "prisonniers de la même étroitesse mentale, superficielle et aphone." Par ailleurs, pour un grand nombre, l'expérience spirituelle dépassait l'expérience politique. Pour la même raison, la libération sociale se limitait à "libérer l'esprit" comme l'avait indiqué William Blake dans "Le Mariage du ciel et de l'enfer", poème mentionné en 1954 par l'essayiste Aldous Huxley : "Si les portes de la perception étaient nettoyées, chaque chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, infinie." La lecture du livre de Huxley sur ses expériences avec le peyotl, The Doors of perception, amena Jim Morrison à appeler son groupe "Les Portes". Le même Morrison commenta l'impulsion qui le poussa à explorer ce qu'il entendait par limites de la réalité : "Je pensais que tout était une grande farce, quelque chose dont on pouvait rire. Je connaissais quelques personnes qui étaient en train de faire quelque chose, qui essayait de changer le monde. Je voulais me joindre au voyage". La marijuana, l'acide lysergique, la mescaline et les mantras se prêtaient davantage à ce genre de changement libérateur entendu comme un "voyage" mental que les méthodes classiques d'agitation. C'est pourquoi la bonne ambiance rituelle des festivals était préférable aux marches de protestation. La presse contre-culturelle parlait d'un "nouveau concept de célébration" émergeant de l'intérieur des personnes de telle façon que la révolution pouvait se concevoir comme "une renaissance de la compassion, la conscience, l'amour et la révélation de l'unité de tous les êtres humains." Le rock prit ce chemin. Le LSD, encore légal, popularisé par Timothy Leary, les Merry Pranksters de Ken Kesey (l'auteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou) et Neal Cassady (Dean Moriarty dans Sur la route), produit en grande quantité et distribué gratuitement dans les grands rassemblements festifs hippies, fut le véhicule utilisé par musiciens et auditeurs, qui au début n'étaient guère différenciés dans cette ambiance communautaire. Les Grateful Dead, la mort qui annonce la renaissance - c'est pourquoi elle est reconnaissante - étaient le groupe des hippies par excellence. Dans Acid Test, Tom Wolfe décrit par la bouche d'un autre "l'étrange son des Grateful Dead ! Une agonie-dans-l'extase ! Sous-marine, trouble la moitié du temps, extraordinairement bruyante, mais comme si on était assis sous une chute d'eau pleine de vibratos genre spectacle de vampires, comme si les cordes des guitares électriques s'étendaient sur la moitié d'un pâté de maisons, et résonnaient dans une pièce emplie de gaz naturel, sans parler de leur grand orgue électrique Hammond, on dirait un juke-box de cinéma, une machine de diathermie, une radio locale et un camion de voirie qui broie ses ordures, vers quatre heures du matin, tout ça sur la même fréquence". Avec ironie, Eric Burdon dédia une chanson à Sandoz, la multinationale qui fabriquait l'acide (aujourd'hui Novartis). Le psychédélisme démarra avec "You're gonna miss me" du groupe garage 13th Floor Elevators, les premiers à utiliser ce terme pour définir leur musique faite à base d'hallucinogènes. À noter que le M de "marijuana" est la treizième lettre de l'alphabet. Cependant, la drogue ne pouvait pas figurer dans les paroles des chansons; ainsi, vers la même époque, un autre groupe pionier, The Charlatans, vit comment sa maison de disques rejetait sa version de "Codine" écrite par la chanteuse folk Buffy Sainte-Marie car les paroles évoquait l'addiction à la codéine. La nouvelle philosophie fut synthétisée par Timothy Leary dans la grande rencontre hippie de janvier 1967 au Golden Gate Park de San Francisco, le Human be-in, avec une phrase magique : "Turn on, tune in and drop out" ("Connecte-toi, syntonise et oublie le reste").
L'acide fut l'ingrédient qui permit de fusionner rock, folk, blues, soul, free jazz et country, produisant ainsi la musique de la révolution américaine. Elle expulsa la négativité de la classe moyenne urbaine frustrée, donnant aux fugitifs du bien-être une vision positive du futur, certes simpliste, mais qui semblait fonctionner dans des collectifs homogènes pas trop grands qui parasitaient les restes de l'empire. Le radical yippie Abbie Hoffman, dans son ouvrage explicitement intitulé Volez ce livre, fit le compte-rendu de centaines d'expériences alternatives fonctionnant en dehors des circuits de l'argent. Les musiciens, britanniques comme américains, cherchèrent de nouvelles sonorités pour exprimer les états inexplorés de l'esprit. Pour les exprimer, les chansons de deux ou trois minutes étaient inutiles, de même que les petits disques de 45 tours; les grands 33 tours étaient plus appropriés. En 1966 parurent "Good Vibrations" des Beach Boys en tant que partie d'un LP inachevé; "Paint it black", dans la version américaine de l'album Aftermath des Rolling Stones; et le LP des Beatles Revolver, ces derniers, voulant donner une image moins frivole avaient abandonné leur ligne pop et renonçaient à donner des concerts. La technologie contribua assez à l'expérience sonore. Les studios d'enregistrement permettaient toutes sortes de mixages. Les boîtes appelées pédales, car elles s'allumaient et s'éteignaient avec le pied, créaient de nouveaux effets de guitare, soit en modulant le son comme la wah-wah, soit en le distortionnant comme la fuzz. "Voodoo chile" et "Purple haze" de Jimi Hendrix en sont deux exemples. Le mellotron, prédécesseur des samplers, permettait de reproduire par un clavier des sons enregistrés sur bande au préalable (les trompettes de "Strawberry fields forever" sont de son fait). Nous pourrions ajouter à la liste divers instruments tels que violons électriques, guitares à douze cordes, claviers divers, thérémine, banjo, sitar, bongos, bouteilles, etc., qui apportèrent leur grain de sable à la création du rock psychédélique. Lothar and the Hand People, groupe qui avait composé un insolite "Space hymn", alla jusqu'à considérer le synthétiseur Moog ("Lothar") comme son leader. La principale caractéristique du psychédélique était l'improvisation. Les chansons, interprétées en direct, dérivaient en de longs solos de guitare spontanés, traduisant une échappée sous acide de la vie urbaine névrotique qui absorbait la réalité quotidienne. Nous choisissons au hasard "Eight miles high" des Byrds, "The Pusher" de Steppenwolf, "East-West" du Paul Butterfield Blues Band, qui est un solo d'un bout à l'autre, "The End" des Doors et toutes les chansons de Grateful Dead en direct, de "Viola Lee Blues" à "Morning Dew". Nous pourrions citer aussi l'oppressant "Sister Ray" du Velvet Underground, mais ce groupe se situait à l'extrême opposé des hippies, appartenant à une mouvance pessimiste et autodestructrice qui avait remplacé l'acide par l'héroïne. Même si Canned Heat et Janis Joplin portèrent mieux que personne l'acide au blues, et les Jefferson Airplane résumaient mieux que personne l'esprit hippie avec des chansons accrocheuses comme "Somebody to love", les charismatiques Grateful Dead, groupe aux capacités musicales incroyables, furent le modèle de la création psychédélique et la musique par excellence du décrochage généralisé de cette fin de décennie. Les écoutant en ces jours-là, on comprenait que sans le rock la vie aurait été une erreur.
Nous sommes les volontaires d'Amérique (We are volunteers of America)
San Francisco, et particulièrement le quartier de High Ashbury, semé de mansions délabrées où résidaient plusieurs groupes connus, devint le pôle d'attraction hippie. John Phillips, de The Mamas & the Papas, composa pour Scott McKenzie une chanson qui commençait par "Si vous allez à San Francisco, assurez-vous de porter des fleurs dans les cheveux", saisissant à la perfection la béatitude de ce moment. Les autorités locales s'alarmèrent devant la possibilité d'une invasion de vagabonds et de bohémiens freaks, c'est pourquoi une trentaine de collectifs contreculturels entre lesquels figuraient la commune Family Dog, les Diggers, The Straight Theatre et le journal underground San Francisco Oracle, aidés par des églises, organisèrent un Été de l'Amour où tout serait gratuit : musique, nourriture, acide, assistance médicale, habits, sexe... Le festival Monterey Pop attira les foules. San Francisco se remplit d'adolescents fugueurs, de curieux, de paumés sans point d'attache, d'obsédés, de trafiquants, de voyous, de profiteurs... Le succès de cet été avait dépassé les prévisions les plus optimistes, menaçant l'existence de la communauté de High Ashbury jusqu'au point de devoir forcer en octobre un "Enterrement du hippie", célébration où l'on recommenda vivement aux je-m'en-foutistes de rester chez eux et à faire la révolution dans leurs villages parce que à San Francisco c'était fini. Ce fut le tour des Flower Children, ces fils des classes aisées qui les week-ends portaient des chemises à fleurs aux couleurs criardes et se mettaient des rubans dans les cheveux. Les Seeds leur écrivirent une marche. Le style hippie se transforma en mode et les freaks abandonnèrent la ville pour laisser place aux touristes. La musique perdait son âme, retournant au divertissement. Les concerts commencèrent à être payants. La contreculture, gratuite et désordonnée, devenait un produit étudié pour la consommation. L'industrie du spectacle accumulait davantage de pouvoir, recrutant dans les groupes les meilleurs artistes pour en faire des pop stars à coup de chéquier. Si Surrealistic Pillow des Airplane représentait le côté face du psychédélisme, son message libre, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles en était le côté revers, son officialisation bien rémunérée. Les Mothers of Invention imitèrent grotesquement la pochette dans un LP intitulé We're Only in It for the Money ("Nous n'y sommes que pour l'argent"). Nous aurions été plus indulgents si les Beatles n'avaient pas accepté la commande de la BBC d'écrire une chanson avec tous les poncifs floraux, "All you need is love", diffusée pour la première fois au monde via satellite. C'était un sale temps pour la paix et l'amour véritable; les faucons qui souhaitaient attiser la guerre au Viêt Nam n'étaient pas impressionnés par les psalmodies hippies. Mais les déserteurs s'organisaient, les minorités raciales se défendaient l'arme au poing, tandis que se succédaient marches sur le Pentagone, défilés à Wall street et occupations d'universités, démonstrations initialement pacifiques qui se terminaient en affrontements violents avec la police. En 1968, la non-violence perdait du terrain, se contentant de suivre les événements au lieu de les précéder. Les rues étaient en effervescence. En mars, une immense manifestation contre la guerre dans le Londres pacifique face à l'ambassade américaine se termina par le matraquage de manifestants. Les Stones sortirent un single, "Street fightin' man", avec une image des agressions policières sur la pochette. La pochette de l'album d'où il était tiré, Beggars banquet, sur laquelle apparaissait une cuvette de WC avec des inscriptions offensantes sur le mur, fut également censurée. Digne parure de celle qui fut sans doute la meilleure chanson de la décennie, "Sympathy for the devil", fille bâtarde des Fleurs du mal et de Le Maître et Marguerite, de Baudelaire et Boulgakov; ce dernier publié de façon posthume en 1966, tournait en dérision la paranoïa bureaucratique du régime stalinien qui avait réduit Boulgakov au silence de son vivant. Les Stones furent le seul groupe qui prêta attention à Mai 68, et évidemment, ce mois-là ne fut pas un thème du répertoire rock.
Aux États-Unis, une patrouille de la police routière avait tiré de manière indiscriminée à Orangeburg, Caroline du Sud, sur une manifestation d'étudiants noirs, en tuant trois et en blessant vingt-huit autres. Martin Luther King fut assassiné par un tireur embusqué. Le FBI commençait son travail criminel destiné à en finir avec celui qui fut désigné ennemi numéro un de l'État, le parti des Black Panthers. Avec autant de morts, la tactique non-violente avait du plomb dans l'aile. Beaucoup considéraient que le système ne pouvait être changé de gré, et ils envisageaient le faire de force. Toutefois, le mouvement contre la guerre joua sa dernière carte à Chicago, ville où devait se réunir en août 1968 la Convention du parti démocrate pour choisir le candidat présidentiel. Les radicaux convoquèrent une concentration de type festif. Graham Nash, du groupe C, S, N & Y, écrivit après coup une chanson sur l'événement. La diffusion de "Street fightin' man" fut interdite par crainte d'incidents, même si personne n'avait fait appel à l'affrontement. Comme à l'accoutumée, on comptait sur la répercussion médiatique des actes alternatifs comme instrument de pression politique. Plusieurs groupes s'étaient engagé à participer, mais finalement seuls jouèrent ce jour-là les MC5, atout du parti des White Panthers, qui considérait le rock comme une arme révolutionnaire. Norman Mailer couvrait l'événement pour Harper's Magazine et William Burroughs pour Esquire. Au début, tout se passa tranquillement; on présenta comme candidat le cochon Pigasus au milieu des rires et du brouhaha, mais le zèle répressif du maire démocrate fit que les choses s'envenimèrent et que la guerre à la guerre finisse en combat de rue. Il y eut de nombreux blessés et arrestations, les radicaux les plus connus furent poursuivis. En novembre, Richard Nixon remportait les élections ce qui laissait prévoir un durcissement répressif et une tolérance zéro non seulement envers le radicalisme, avec les assassinats de militants Black Panthers, mais aussi envers des conduites véniellement transgressives, comme le montrait la condamnation de John Sinclair à dix ans de prison pour possession de deux joints. C'est dans ce contexte agité que fut annoncé le festival de Woodstock qui devait se tenir en août 1969, dans l'état de New York, avec une liste impressionnante de groupes. Un demi-million de personnes assistèrent au festival, beaucoup plus que ce qui était prévu. L'organisation fut chaotique, il pleuvait sans arrêt et certains, comme les Motherfuckers ("une bande de rue avec de l'analyse"), se fâchèrent lorsqu'on voulut leur faire payer l'entrée. Ils brisèrent les clôtures et tout le monde put occuper son bout de terrain boueux. Les pertes seraient épongées avec le disque et le film. Les radicaux distribuèrent de la propagande, parlèrent de paix et d'amour, et réclamèrent la libération de Sinclair; tout cela avec un air de déja-vu. Jimi Hendrix "déconstruisit" l'hymne américain devant un public endormi. Woodstock représentait le nouveau conformisme de la jeunesse américaine, composée en majorité de Blancs sans problèmes économiques, uniquement capable de rester calme, extasiée, passive, face à des musiciens transformés en stars pour lesquels elle sentait une dévotion fétichiste, avec la bonne conscience qu'il suffisait d'être présent; l'entassement passait pour de la fraternité et la défonce, pour une libération. Pour rien au monde elle ne voulait s'engager, ni participer à quelque chose de plus consistant. Woodstock reproduisait la séparation spectaculaire entre public et acteurs, entre réalité et image, l'une aussi vide que l'autre est rentable. Ce n'était rien d'autre qu'une somme de performances dont le degré subversif était nul dans une ambiance de rébellion stéréotypée, une ruine en apparence qui donnerait lieu à un substantiel jackpot. Comme pour confirmer la vision pessimiste du film de l'année, Easy Rider, dirigé par Dennis Hopper, où à la fin les hippies protagonistes sont abattus par des Américains "profonds". Une dérive qui finit mal. Prémonitoire. En septembre eut lieu le procès des "Huit de Chicago", pour conspiration et incitation à la violence. Le procès suscita un grand intérêt et Nixon envoya la Garde nationale pour contrôler les manifestants sous la menace des armes. Devant le tribunal, les accusés saisirent l'occasion pour retourner les accusations et ridiculiser le système judiciaire américain. Bobby Seale, dirigeant des Black Panthers traita le juge de "cochon fasciste"; il le fit juger séparément et le condamna à quatre ans de prison pour outrage. Les autres accusés, faute de preuves crédibles, s'en sortirent bien. Le même mois, l'apôtre du LSD Timothy Leary poursuivait son défi contre le gouvernement américain en se présentant au poste de gouverneur de Californie face à l'ultraconservateur Ronald Reagan. Pour son extravagante campagne, les Beatles composèrent "Come together". La chanson fut boycottée par la BBC car les censeurs pensaient que la phrase "He shoot Coca Cola" faisait allusion à la cocaïne. Leary, qui rejetait les narcotiques, fut condamné à dix ans d'emprisonnement pour le sachet de marijuana découvert lors d'une fouille.
Ceci est la fin, mon ami, la fin (This is the end, this is the end, my friend)
Comme il n'y a pas deux sans trois, quelques malins voulurent répéter le coup de Woodstock sur la côte ouest. La police de San Francisco avait blindé la ville contre les festivals, c'est qui fait que le lieu choisi pour la tenue du Speed free festival fut Altamont, au nord de la Californie. Les Rolling Stones servirent de réclame pour cette nouvelle célébration dont le service d'ordre devait être garanti par les Hell's Angels, une bande de motards tout à fait opposée à la mouvance hippie. Ni les assistants au concert, ni les Hell's Angels restèrent tranquilles. L'alcohol mélangé aux amphétamines, une substance psychotrope qui provoque l'hyperactivité, surpassa l'acide et tout cela dégénéra en avalanches et en bagarres, où musiciens et public furent tabassés à parts égales. Quatre morts certifièrent la fin de la "nation Woodstock" seulement quatre mois après son apparition. À Altamont, la masse consommatrice ne se supportait même plus elle-même, et dans son hystérique perte de contrôle elle endura l'intempérance d'un service d'ordre qui exerçait sa fonction de la même façon que l'aurait fait la police. Ce ne fut pas le pire jour du rock, ce fut la mort du rock tel qu'il avait été jusque là. Il était en train de devenir une composante de plus de la culture de masse et un véritable business capable de tirer profit de n'importe quelle situation. Lorsque le 4 mars 1970 la Garde nationale ouvrit le feu sur les étudiants universitaires de Kent (Ohio) en tuant quatre, le cycle de la révolution américaine se conclut. Neil Young, de C, S, N & Y, composa une chanson sincère de protestation intitulée "Ohio". Ce fut un succès qui ne servit à rien; les assassins ne furent pas inquiétés. Young signalait avec tristesse que finalement les morts malheureuses en question n'avaient fait que lui rapporter de l'argent. Le 15 mai de la même année, la police tira sur les étudiants de l'Université d'État de Jackson, Mississippi, qui protestaient contre l'invasion américaine du Cambodge, tuant deux jeunes et en blessant quatorze. Et le 10 juin, après des mois de tumulte, la police envoyée par le gouverneur Reagan chargeait brutalement les étudiants de l'Université de Californie, à Santa Barbara, lors d'une manifestation au Perfect Park d'Isla Vista contre l'imposition de la loi martiale dans cette zone, principal foyer du radicalisme. Il y eut des centaines d'arrestations après de violents affrontements. Un groupe de plage BCBG, que les drogues avaient rendu meilleur, transforma "Riot in Cell Block Nine" en une chanson consacrée aux révoltes, "Student Demonstration Time", mais sans la moindre répercussion : une année s'était écoulée, la chanson ne sortit pas en single et puis... il s'agissait des Beach Boys ! Groupe qui avait débuté avec une conversion de signe contraire en transformant "Sweet little sixteen" de Chuck Berry en l'écœurant "Surfin' USA". Le show business et l'industrie discographique avaient dépassé en audace les contestataires (certes, les forces de l'ordre et les drogues dures aplanissaient le chemin.) Le même mois de juin, le Summer Pop Festival de Cincinnati, également dans l'Ohio, lança des groupes précurseurs, comme The Stooges ou Grand Funk Railroad. En août 1970, il y eut une tentative visant à retrouver la "magie" de Woodstock à Goose Lake (Michigan) à laquelle donna crédibilité la présence des White Panthers et de la coalition STP - Serve the People ou Stop the Pigs, selon les préférences - œuvrant pour la libération de Sinclair et de tous les prisonniers politiques. Le jour choisi ne fut pas un hasard; c'était le vingt-cinquième anniversaire des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, donc l'idée sous-jacente était antinucléaire. Mais il s'agissait plus d'un ornement et d'un prétexte que d'un vrai message. À l'affiche, des groupes vétérans et nouveaux, tous blancs, parmi lesquels il faut souligner, mis à part la présence des groupes belliqueux de Detroit, le groupe Chicago et Ten Years After qui jouèrent devant une multitude de 200'000 personnes, la plupart défoncées, qui donnèrent peu de travail à un service d'ordre amical. La présence du cheval fut notoire; les drogues comme l'héroïne étaient les mieux indiquées pour une unification virtuelle de tout ce qui en réalité demeurait séparé. Étrangement, les dealers qui s'en donnèrent à cœur joie, ne furent pas inquiétés par la police. Même pour les moins lucides, il y avait un arrière-goût amer de cirque, de ghetto, de trafic, qui marquait sans le moindre doute la fin d'une époque. Les festivals se poursuivirent, à Toronto, sur l'île de Wight et ailleurs, sans que la domination ne bronche. Ce n'était pas que le Pouvoir cédait du terrain devant une troupe disposée à ne pas batailler, c'était juste qu'il apprenait à se moderniser. Les hallucinogènes étaient pour beaucoup le seul moyen de se défaire des valeurs inculquées par le système, le chemin de l'union de l'individu libéré et conscient de son être profond avec le cosmos; le système semblait le penser aussi puisqu'il punissait avec acharnement leur utilisation.
Mais, dès lors que le système changeait de valeurs et adoptait celles de ses critiques, les drogues changeaient de fonction : elles formaient partie d'un mécanisme d'évasion, aussi bien les opiacés que les amphétamines, les plantes et les champignons sacrés des Indiens. Toutes obéissaient à un désir pervers d'ébriété, non de conscience, elles étaient donc un instrument de réadaptation. Le drop out était une invitation à oublier les conventions, mais cela débouchait sur la passivité, non sur la transformation révolutionnaire de la société. Le cadre du festival, tolérant avec les stupéfiants, servait de soupape, cérémonial du je-m'en-foutisme apprivoisé, pause relaxante entre deux moments de soumission. D'un côté l'interprète, de l'autre le public drogué, et au milieu les gorilles. Le public défoncé se limitait à reproduire des schémas stéréotypés de rébellion virtuelle, anticipant ainsi des modèles d'intégration aux marchands fûtés de la culture.
La société industrielle avancée commençait à pratiquer un laissez-faire qu'elle appelait tolérance, plus propice à ses intérêts. C'était le genre de tolérance répressive que favorisait la tyranie de l'appareil car elle correspondait à la nécessaire transition capitaliste du conservatisme à la permissivité. La société de consommation n'est pas ascétique et régulée, mais hédoniste et transgressive. Avec une vitesse inusitée, la société spectaculaire de marché adoptait finalement une morale laxiste et utilitaire plus en accord avec le développement économique et ne se scandalisait de rien. Elle ne respectait même pas les morts : les cadavres de Brian Jones, Keith Moon, Janis Joplin, Jimi Hendrix ou Jim Morrison furent impitoyablement mythifiés. Vivre vite, mourir jeune et faire un joli poster. Le système était également monté dans le wagon du rock, de la méditation transcendantale, de la psychanalyse, du sexe et de la marijuana, et il n'avait guère de peine à supporter les messages désenchantés et le comportement histrionique et autodestructeur des nouveaux rockers impliqués dans une musique rude et fracassante. Des chansons comme "TV Eye" d'Iggy Pop ou "School's out" d'Alice Cooper ne réveillaient plus la censure. Le système, jusqu'à un certain point, laissait faire. Il n'y avait pas de futur, de futur révolutionnaire s'entend. Il y eut bien des événements qui révélèrent le vrai visage de ce fascisme latent présidé par Nixon comme l'assassinat de George Jackson, un des "Soledad Brothers", aux mains des gardiens de la prison de San Quentin le 21 août, et le massacre des mutinés de la prison d'Attica planifié par le gouverneur Rockefeller un jour de septembre 1971. Dylan enregistra à la guitare acoustique deux versions de son "George Jackson", single qui ne figurera sur aucun album. Tom Paxton écrivit "The Hostage", chanson narrative dans la meilleure veine folk consacrée aux événements d'Attica. Et le même John Lennon sortit une ritournelle agréable baignée d'un pacifisme dépassé, idéale pour les inconditionnels. Il se peut que les temps n'étaient plus à la chanson, mais avec des centaines de militants qui s'inscrivaient à la guérilla urbaine, il est certain qu'ils n'étaient pas disposés à écouter des discours bon enfant du style "allons ensemble avec le mouvement, prenons parti en faveur des droits de l'homme". La phrase dylanesque de "Subterranean homesick blues" était plus opportune : "Pas besoin d'un monsieur météo pour savoir d'où souffle le vent". En effet, "Weathermen" fut le nom choisi par la plus grande organisation armée nord-américaine des années soixante-dix.
Plus on s'élève et plus dure sera la chute. Signe du changement d'époque, le début des années soixante-dix voit les groupes les plus authentiques arriver au zénith de leur créativité en pleine contre-révolution, produisant des œuvres qui agressaient le goût des masses modérément rebelles qui les avaient porté au sommet, avant de se décider à faire partie de la "majorité silencieuse" de Nixon et Agnew. Plusieurs groupes refusaient le rôle d'idole reflétant les nouvelles valeurs conformistes, ce qui les conduisaient à la dissolution (Beatles, Doors) ou à la copie d'eux-mêmes (Temptations, Sly and the Family Stone). Les Stones après Exile on Main street ne cessèrent de se répéter. D'autres se relâchaient, faisaient marche arrière ou s'épuisaient (The Band, Byrds, Kinks, Who) sans que certains ne se dispensent de laisser à la postérité une ennuyeuse et prétentieuse "opéra rock". Finalement, il y en eut qui optèrent pour des changements de style invraisemblables; c'est le cas des Jefferson Starship, les restes honteux du naufrage d'Airplane. D'un autre côté, le rock légitime, celui que pouvaient représenter Captain Beefheart, Tom Petty, Lou Reed, Patti Smith ou les Ramones, par exemple, était devenu minoritaire et progressivement dépolitisé. Dans un contexte destroy, nihiliste et coléreux, où le Chaos était l'objectif le plus séduisant, le mot "hippie" prit une connotation de vétusté, d'idiotie et d'impuissance. Hors quelques cercles restreints de résistants, le rock avait perdu son aura et, soit qu'il s'engageât soit qu'il se prêtât à l'évasion, il devenait prévisible et routinier, sophistiqué et lourd; une musique décadente conçue par des narcisses pour distraire une jeunesse onaniste qui réclamait sa dose d'aliénation symphonique ou autre. Une musique, d'une certaine façon, optimiste qui tranquilisait et relaxait, ainsi que le souhaitait le nouvel ordre. Les innovations techniques des années soixante-dix comme les samplers, synthétiseurs et boîtes à rythmes engloutirent la guitare, la basse et la batterie. "Family Affair" de Sly Stone fut la première chanson sortant d'une de ces boîtes, chose qui devint habituelle peu d'années après avec la musique disco. D'autre part, le rock nouveau était moins de la musique que du cirque : il établissait avec son public une relation médiatisée par l'image et le glamour. La vedette dépendait plus du coiffeur, du garde-robe et de la télévision que de son talent. La séparation est la règle du spectacle, qui se perpétue dans la communion béate avec l'image de l'"idole", que ce soit à travers le shock scénique ou à travers du get high avec les drogues. Le vidéo-clip promotionnel prit de l'importance dans le domaine privé; en direct, on révolutionna la mise en scène au moyen d'effets divers, logotypes, jeux de lumières, effets pyrotechniques, fumigènes, projections, grues, passerelles, plates-formes, choréographies... Le "fan" devint le parfait animal domestiqué. Le bruit assourdissant des équipements, de plus en plus puissants, combiné avec les lignes de coke, les pastilles et l'eau minérale parvenait à provoquer chez lui une espèce de frénésie autiste, la forme onaniste de la passivité. Cette auto-agitation masochiste se généralisa avec la renaissance des discothèques, plus grandes et mieux conçues, qui donnèrent le coup de grâce à la musique en direct dans les pubs, théâtres et autres salles. Un genre de musique facile et répétitif émergea et fit fureur, organisée par un nouveau maître de cérémonie, le disc jockey. Les paroles et les accords se réduisirent à leur plus simple expression. Le rythme fut simplifié au maximum et occupa l'espace de la mélodie qui dégénéra en jingle. Un nouveau support audio comme la cassette promettait de démocratiser l'enregistrement le rendant accessible à n'importe quel groupe, mais ce ne fut pas le cas parce que la musique pop avait changé de fonction. La créativité n'était plus qu'un détail; désormais la pop remplissait le vide d'une vie déterminée par les impératifs de la consommation. Le résultat final était toujours le même : le conformisme. En réalité, la cassette accentua la privacité et le cocooning, amenant cette musique là où ne pouvait le faire le vinyl, en particulier l'automobile, prothèse de l'individu moderne aliéné et symbole de sa puissante impuissance. Les publics se fragmentèrent, les marchés se diversifièrent selon la tranche d'âge et le type de consommateur. Ce fut l'apothéose de l'hédonisme de la marchandise : de la fête, du fun, de la pose cool, des allures branchées. En résumé, l'épiphanie complète du spectacle. L'authenticité se payait par la marginalisation. Là était la force de la société de masse. Aucune option ayant des prétentions de véracité ne pouvait échapper au cercle limité dans lequel elle s'inscrivait, succombant dans la répétition et la banalité aux mains de ses partisans transformés en tribus urbaines. C'est ce qui arriva avec le heavy metal, le reggae, le punk. Le rock ne servait plus de digue contre la barbarie modernisée : c'était un genre fini, un moyen stéril, un fantôme, une relique, une arnaque. C'était désormais la musique de l'autre camp. Il n'existait que parce que de nombreux intérêts en jeu étaient nés à l'ombre de l'industrie de l'évasion. La révolution et le divertissement ne marchaient plus ensemble, l'une perdant sa dimension ludico-populaire, et l'autre son caractère subversif. On peut mieux comprendre les échecs des mouvements révolutionnaires d'alors en prêtant attention à la régression du rock qui traduisait la victoire de la culture-spectacle et la dissolution des classes dangereuses dans les masses consommatrices. Certes, tous ses éléments basiques étaient déjà présents dans les années soixante, mais ce fut lors de la décennie suivante qu'ils se développèrent exponentiellement et sans entraves. Depuis, de nombreux styles musicaux aux intentions plus ou moins louables, et avec des fortunes diverses, ont fait parler d'eux. Aucun n'a dépassé son ghetto particulier, car aucun n'a réussi à exprimer les espoirs universels de liberté et d'autoréalisation comme le rock de cette époque; aucun n'a autant enseigné à désapprendre, ni n'a défié aussi efficacement l'ordre, ni n'a encouragé aussi longtemps la protestation.
Miguel Amorós, Rock para principiantes
![]()
amorós va à l'essentiel (le livre compte une soixantaine de pages) mais n'oublie aucun des moments cruciaux de l'évolution du rock dans la société de classes et de consommation, l'extrême violence étatique qui s'est manifestée en amérique contre la jeunesse dans les années 60 et 70, et le rôle que le rock a parfois joué dans la contestation de cette société.
texte en anglais : https://libcom.org/library/roc(...)mor-s
ROCK POUR DÉBUTANTS
Frémis, balance, roule (Shake, rattle and roll)
Nous parlons de rock proprement dit en nous référant à un style musical déterminé créé par la sous-culture juvénile anglo-saxonne qui fit tache d'huile dans tous les pays où les conditions modernes de production et de consommation avaient dépassé un certain niveau qualitatif, c'est-à-dire, là où le capitalisme avait accouché d'une société de masse. Le phénomène prit forme d'abord aux États-Unis pendant la dernière après-guerre mondiale, le pays capitaliste le plus développé, pour passer ensuite en Angleterre, avant de retourner tel un boomerang au pays d'origine projetant son influence partout, meublant et changeant de diverses façons la vie des gens. Pour nous approcher du rock sans équivoques, il faudrait auparavant revoir les concepts de sous-culture, musique et jeunesse.
Le terme de "sous-culture" faisait référence aux conduites, valeurs, langages et symboles d'un environnement différencié - éthnique, géographique, sexuel ou religieux - à l'intérieur de la culture dominante, qui était et demeure, cela va de soi, la culture de la classe dominante. À partir des années soixante, une fois opérée depuis en haut la séparation entre la culture des élites, réservée aux dirigeants, et la culture des masses, conçue pour uniformiser les dirigés, leur abrutir le goût et brutaliser les sens - entre la high culture et la masscult, pour reprendre la terminologie de Dwight Macdonald - le terme exprimera plutôt des styles de vie consommatoires alternatifs, reflétés d'une certaine façon dans la musique qui au début s'appela "moderne" et ensuite "pop". Le mécanisme d'identification que produisait la sous-culture juvénile était éphémère car il était annulé par le caractère passager de la jeunesse. Dans cette étape volatile de la vie, sans responsabilité ni fonction économique, avec un prolétariat qui ne donnait pas de signe de lutte, la notion de sous-culture pouvait se confondre avec celle de mode, et celle de liberté, avec celle de look. Le rôle des médias, qui ne prêtaient guère d'attention aux sous-cultures traditionnelles, sera décisif dans la diffusion des modes pour la jeunesse. Dans ces modes se cachait une réalité plus inquiétante. Même si l'opposition au monde adulte apparaissait comme crise générationnelle, il s'agissait en fait d'une crise sociale non résolue. Ainsi, l'"éternelle crise de la jeunesse" finit par confluer avec d'autres types de crises - étudiante, du travail, raciale, politique - forgeant une authentique alternative éthique, artistique et sociale face aux valeurs et aux manières de la domination. Le rock fut sa bande son. On ne pouvait plus l'appeler sous-culture car elle ne cherchait pas à se faire une place dans la culture dominante contrairement aux styles précédents - par exemple, les bandes de quartier et de motards aux États-Unis, ou les teddy boys et les mods en Grande-Bretagne - car elle la subvertissait et tentait de la renverser : c'était quelque chose de pire, une véritable "contre-culture" qui n'était pas réservée uniquement aux jeunes.
D'autre part, la pop music a très peu à voir avec ce que l'on entend par musique. Bien que techniquement on puisse la considérer comme une organisation de sons dans le temps, il ne s'agissait pas d'un art mais plutôt d'un produit de l'industrie des loisirs, une marchandise du show business. Nous traduirons le terme par "musique légère" en opposition à la grande musique ou musique savante, qui alors commença à s'appeler "classique". Elle se caractérisait par la simplification et la standardisation; elle était faite pour accompagner la danse et servir de passe-temps et d'évasion. Les morceaux étaient courts, répétitifs et syncopés, prévisibles, sans prétentions esthétiques. Ils ne prétendaient pas révéler l'essence de la réalité dans son immédiateté comme se le propose l'art, mais animer et distraire. Son but était d'amuser, pas de défier l'ordre établi. Une musique pour passer du bon temps, se distraire, pour consommer et ne pas penser; musique qui servait de cheval de Troie de la raison marchande dans la vie quotidienne. Theodor W. Adorno affirme que "se divertir signifie être d'accord", et fondamentalement c'était cela : les musiques de danse représentaient, musicalement sublimés, les rythmes du travail et du mal-être quotidien. Elles promouvaient le conformisme plutôt que la rébellion. La culture de masse dont elles faisaient partie n'était pas vraiment une culture mais une industrie particulière qui s'enracinait dans la vie quotidienne à travers la communication de masse. Celui qui commandait dans les médias dominait dans cette culture qui, loin d'éclairer et d'exacerber les contradictions de la société capitaliste, les brouillaient et les estompaient, les rendant supportables. C'était la principale caractéristique du nouveau capitalisme basé sur la consommation, donc sur l'industrialisation du vécu. Même si la pop music n'était en rien l'expression de la situation sociale de la classe exploitée, elle put à un certain moment et dans des circonstances déterminées se transformer en véhicule des exigences de liberté manifestées par le secteur le moins docile de la population et le plus sensible à la crise : les jeunes. Elle parvint donc à être porteuse de vérité, qui pour Hegel est aussi beauté, et à manifester spontanément, de façon subjective et incomplète, faisant davantage appel aux sens - ou aux "bonnes vibrations" - qu'à la raison, l'esprit de la révolution sociale moderne.
En troisième lieu, la jeunesse, cette période entre l'enfance et la vie adulte, plus longue chez les fils de la bourgeoisie, très courte chez les fils de travailleurs, ne comportait rien de particulier dans le capitalisme classique. C'était une période d'initiation à la vie "responsable" où n'étaient admis que les principes et goûts de l'ordre établi. La découverte d'une jeunesse rebelle et conflictuelle qui questionnait les règles du monde des adultes fut traumatisant aussi bien pour la classe dominante que pour les classes résignées car elles étaient toutes patriarcales. Un moyen de communication comme le cinéma permit, pour un temps, à certains créateurs intellectuellement honnêtes de cesser de transmettre les messages du pouvoir pour traiter certains des aspects désagréables de la crue réalité. La Seconde Guerre mondiale fut suivie par la "guerre froide", une époque de tension politique exacerbée par la fabrication russe de la bombe atomique, l'arrivée au pouvoir de Mao Tsé-toung et le début de la guerre de Corée, événements qui provoquèrent aux États-Unis une vague de patriotisme et d'anticommunisme dont profita le sénateur Joseph McCarthy pour organiser une "chasse aux sorcières" qui atteignit de plein fouet le travail intellectuel et artistique. Les années du "maccarthysme", entre 1950 et 1956, furent néfastes pour les libertés formelles qui avaient régi la culture d'un État qui en devenant la première puissance mondiale se sentait menacé de l'intérieur. Dans ce climat suffocant, n'importe quel signe de dissidence était considéré comme communiste et réprimé vigoureusement. Au cinéma, la condition ouvrière était taboue; les syndicalistes étaient toujours représentés en mafieux, et les héros en délateurs, comme dans le film d'Elia Kazan, Sur les quais. La question raciale ne fut posée au grand public qu'en 1960 avec Le Sergent noir de John Ford et le roman de Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, adapté au cinéma en 1962. Néanmoins, le problème de la jeunesse, ignoré par les nouveaux inquisiteurs, accéda à la publicité sans grands obstacles. En 1953, apparaît dans les salles de cinéma L'Équipée sauvage de Laszlo Benedek qui traitait d'un fait véridique : l'invasion d'un village paisible par une bande de motards violents. Le contraste entre le respect de l'ordre de la part des villageois et la conduite irrespectueuse et sans normes des jeunes motards atteignait son apogée lorsqu'à la question de contre quoi ils se rebellaient, le protagoniste, incarné par Marlon Brando, répondait : "contre tout". Le nihilisme du message scandalisa les dirigeants; la firme Triumph protesta en raison de la mauvaise image conférée à ses motos et le gouvernement anglais ne permit pas la diffusion du film jusqu'en 1967 et uniquement dans des salles X ! En 1955, un deuxième film intitulé La Fureur de vivre (Rebel without a cause), dirigé par Nicholas Ray, donnerait une autre tournure au thème en le déplaçant des marges vers le centre de la société américaine : un jeune issu de la classe moyenne, interprété par James Dean, angoissé et insatisfait, perdu dans un milieu social qu'il ne voulait pas comprendre, le trouvant absurde, réagissait en se permettant n'importe quoi, sans motif apparent, uniquement "parce qu'il fallait bien faire quelque chose". L'image d'un adolescent violent et désemparé, convaincu qu'il n'y avait pas de futur qui en vaille la peine et qu'il ne restait plus qu'à vivre l'instant intensément comme si l'on allait mourir ce jour même, tournant le dos au monde adulte insensible à son mal-être, reflétait la décadence morale d'une société de classes qui au lieu de réponses offrait des dollars. L'ancienne génération, satisfaite et résignée, incapable de voir autre chose en dehors de soi-même, était devenue étrange pour la nouvelle. Le tableau fut complet avec Graine de violence de Richard Brooks, également sorti en 1955. L'action se déroulait dans un lycée de quartier où les jeunes issus de familles ouvrières, que l'on qualifierait aujourd'hui de "destructurés", attrapés dans un système d'enseignement qui ne leur était d'aucune utilité pour la vie pénible qui les attendait une fois qu'ils auraient atteint dix-huit ans, s'en prenaient aux professeurs et à l'école. L'indiscipline et la délinquance était la réponse à l'absence de perspectives et au destin réservé aux perdants. La musique diffère des deux films précédents. La bande son de L'Équipée sauvage était du jazz, celle de La Fureur de vivre fut écrite par un compositeur de musique dodécaphonique disciple de Schönberg. En revanche, dans Graine de violence, les élèves détruisent la collection de disques de jazz du professeur de mathématiques parce que cette musique ne leur dit rien. Ce qu'ils voulaient écouter c'était des chansons comme "Rock around the clock" de Bill Haley, que le film catapulta vers le succès. Un nouveau style était né, inconnu par les parents, mais qui faisait fureur chez les enfants, le rock and roll, signe d'une crise générationnelle profonde, ou mieux, d'une crise sociale sérieuse ressentie majoritairement par les jeunes.
Le blues de l'été n'a pas de remède (Ain't no cure for the summertime blues)
Une fois, Willie Dixon, musicien, compositeur et interprète de blues, a dit plus ou moins ceci : "Le blues fut l'arbre. Le reste ce sont les fruits." Il avait résumé en une phrase claire l'histoire du rock. Le rock and roll fut une affaire de Noirs. Il avait été créé en 1955 par un guitariste de rhythm and blues nommé Chuck Berry, lorsqu'il enregistra et eut du succès avec "Maybellene", adaptation d'une chanson country. Le rock naissait donc, comme chacun sait, de la fusion entre rhythm'n'blues et musique "paysanne", qui est le sens de "country". Elvis Presley avait enregistré une année auparavant "That's All Right (Mama)", mais apparemment personne n'y avait prêté attention. Quelles étaient les conditions qui avaient rendu possible son apparition ? En premier lieu, évidemment, la crise sociale et morale évoquée avant, manifeste principalement dans la jeunesse. En deuxième lieu, la musique d'une minorité discriminée, les Afro-Américains. En 1947, le journaliste Jerry Wexler avait baptisé sous le nom de rhythm'n'blues un nouveau style de boogie plus connu entre ses interprètes comme jump blues, et qui avait du succès dans les charts "de race" et avait la particularité d'attirer des acheteurs blancs. En 1951, une émission de radio pour la jeunesse de Cleveland transmit cette musique en l'appelant rock'n'roll, expression qui apparaissait souvent dans les paroles des blues accélérés. Les jeunes blancs avaient découverts tout un monde dans la musique noire. John Sinclair raconte dans son livre Guitar Army que les musiciens noirs furent les "chevaliers de la liberté" qui s'introduisirent dans les foyers blancs et séduisirent les rejetons en attaquant tous les tabous. Les fils se sentirent alors beaucoup plus proches des gens de couleur que leurs parents. Leur musique leur enseignait une nouvelle façon d'aimer et de se conduire, moins inhibée, plus fraternelle et, surtout, beaucoup plus érotique; elle leur montrait une sexualité ouverte et, chose intolérable, les incitait à fumer de l'herbe. Il y avait une vie au-delà du travail, loin du lycée et loin du sofa en face de la télévision. De fait, c'était la vie véritable, celle qui, dit philosophiquement, efface la distinction entre le sujet et l'objet. Le rock'n'roll était plus qu'un divertissement; c'était la musique du rejet; rejet de la morale hypocrite et de la culture officielle. En mettant l'accent sur le rythme plutôt que sur l'harmonie, elle faisait sentir d'autant mieux l'antagonisme entre la passion de vivre et l'ennui quotidien duquel les jeunes tentaient de sortir au moyen de la violence et de la transgression, mais sans parvenir à distinguer la situation de manière objective et rationnelle. C'était la musique du déracinement, de l'éveil, du mouvement, mais non de la catharsis révolutionnaire. L'identité juvénile qu'elle fournissait ne suffisait pas à provoquer un changement social, mais il allait timidement dans ce sens. Une contradiction empêchait la prise de conscience sociale. La jeunesse rebelle méprisait le travail, mais elle consommait : elle niait le comptoir et l'usine, mais pas la marchandise, ce qui fait qu'en cherchant une identité basée sur la musique, les habits ou la moto, elle se retrouvait simplement avec une image dont le contenu était sa valeur d'échange. La jeunesse était réellement un marché nouveau, en expansion. N'oublions pas que le rock'n'roll, son étendard musical, était un produit de l'industrie culturelle, des listes du hit-parade, des nouvelles compagnies de disque comme Modern, Atlantic, Chess ou Sun Records, du cinéma et de la radio; des dernières inventions de la technologie musicale, les disques de 45 tours et ceux de 33, les juke-box, les tourne-disques, les amplificateurs. C'était la troisième condition qui amena le rock dans les bars, les salons et les chambres à coucher, c'est-à-dire qui l'introduisit dans la vie quotidienne. Pour la première fois, il était possible d'écouter de la musique à n'importe quelle heure, à n'importe quelle place avec le son poussé à fond, une musique dont l'instrument principal était la guitare, et non le piano ou la voix. Pour Leni Sinclair, épouse de John, "le point d'inflexion de la civilisation occidentale fut atteint avec l'invention de la guitare électrique." Ce fut l'instrument du changement. Les premières Gibson et Fender devinrent des fétiches phalliques aptes pour composer des phrases musicales courtes ou riffs comme celles de "Manish boy", ce mémorable blues électrique enregistré en 1955 par Muddy Waters. La guitare rendait l'orchestre inutile; trois ou quatre musiciens tout au plus étaient suffisants pour l'accompagnement. Chuck Berry et Bo Diddley furent les premiers rockers à écrire leurs propres chansons pour la guitare étant donné qu'ils ne savaient pas jouer d'un autre instrument; ils servirent de modèle à leurs imitateurs blancs et ils leur fournirent des manifestes comme le très emblématique "Rock and roll music" et "Who do you love?" L'un d'eux, Buddy Holly, se fit accompagner par une guitare rythmique, une basse et une batterie, créant le quartet basique qui modèlera la plupart des groupes de pop rock des années soixante. D'autres artistes afro-américains comme Little Richard et Larry Williams, par exemple, montrèrent le chemin interdit de la sensualité avec "Lucille" et "Bonnie Moronie"; Elvis Presley fit le reste. Il avait l'avantage d'être blanc dans une société raciste qui tolérait difficilement le succès des Noirs, ce qui fait qu'Elvis fut déterminant dans l'ascension puis la chute du rock.
Le rock conservait une certaine autonomie créatrice qui le protégeait de la manipulation par le spectacle, mais cela ne dura pas. Le show business prit assez d'ampleur pour annuler son pouvoir négatif et l'obliger à maintenir une relation cordiale avec l'ordre établi. À partir de 1957, le rock'n'roll commença à se corrompre et à se transformer intégralement en montage. L'attitude rebelle fut remplacée par une identité grégaire qui satisfaisait un public obéissant au diktat de la mode à la place d'un sujet collectif autonome. Un grand nombre d'"idoles" adolescentes, bien coiffées, doucereuses et habillées avec correction entonnaient des couplets routiniers et sentimentaux qui, avec la mode des danses qui débuta avec le twist, dominèrent la scène jusqu'à l'apparition des Beatles. Le rock retournait dans le giron de la pop music commerciale, amusante et festive, occultant les inégalités sociales, l'angoisse et l'insatisfaction, modérant son langage de façon à le rendre agréable au goût dominant, le goût de la domination. Adorno a dit que "dans le capitalisme avancé, l'amusement est le prolongement du travail". Eh bien, de caillou dans le soulier de la culture de masse, le rock devenait rite d'initiation de la jeunesse dans le système capitaliste. Elvis revint changé du service militaire, transformé en caricature grotesque de lui-même. "Viva Las Vegas" n'était pas la même chose que "Heartbreak Hotel" ou "Jailhouse Rock". Les figures principales s'eclipsèrent; en février 1959, Buddy Holly et Richie Valens se tuèrent dans un accident d'avion; un an plus tard, Eddie Cochran se tue dans un accident de voiture. "Vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre !" avait dit Bogart il y a longtemps dans le film de Nicholas Ray, Les Ruelles du malheur. Le moment du rock était passé, il était littéralement mort, mais le défunt n'eut pas le temps de se reposer. La marche en avant du commerce eut la vertu de produire de nouvelles contradictions, et ainsi surgit du néant une nouvelle musique moins complaisante : une deuxième génération de jeunes trouva en elle une stimulation suffisante pour ne pas s'enfermer dans la simple répétition et continuer la bataille contre le vieux monde, mieux préparé pour affronter une crise plus profonde qui venait de l'époque précédente, mais aussi plus décomposé, plus irrationnel et plus inadmissible. En entrant dans les années soixante, le rock récupéra l'élément de liberté subjective perdue qui le situa de nouveau comme antithèse de la culture étatiste de masse.
Tu m'as vraiment eu (You really got me)
En ce qui concerne le rock, au début des sixties, la scène américaine comptait de nouveaux arrivants. D'une part, elle disposait d'une nouvelle vague d'arrangeurs, ingénieurs du son et compositeurs pop talentueux. D'autre part, le rhythm'n'blues s'était développé et avait donné naissance à la musique soul, dont une des versions édulcorées pour les Blancs, la musique du label de Detroit Tamla Motown, avait atteint une notoriété spectaculaire. Des chansons comme "Dancing in the streets" ou "Louie, Louie" devinrent indispensables dans les fêtes. Finalement, le folk ressurgit par l'intermédiaire de Woody Guthrie qui portait sur sa guitare l'inscription "cette machine tue des fascistes", et de Pete Seeger, interprète de "We shall overcome". Mêlé au radicalisme idéologique il donna lieu à la "chanson contestataire", idéale pour être interprêtée dans les marches pacifistes de l'époque en faveur des droits civils et contre la ségrégation raciale. Une longue liste d'auteurs-interprètes engagés se donnèrent rendez-vous dans les luttes sociales émergentes, pourtant c'est Bob Dylan, celui qui se prêta le moins à figurer politiquement, qui fut de loin le plus influent. Certaines de ses chansons, de "Blowin’ in the wind" à "Like a rolling stone", en passant par "The Times are a-changin’" et "It’s all over now, baby blue", devinrent des hymnes impérissables. Mais ce qui révolutionna vraiment la scène musicale fut son apparition orageuse au festival de Newport en 1965 avec une Stratocaster au lieu d'une guitare acoustique, accompagné par Mike Bloomfield et Al Kooper. Lorsqu'ils commencèrent à jouer les premiers accords de "Maggie's farm", cela sonnait comme un groupe de blues de Chicago. Sa musique tendait des ponts vers le rock de cette époque, ainsi que Jimi Hendrix, Manfred Mann, Julie Driscoll, The Band et en particulier The Byrds se chargèrent de proclamer, ou même vers la pop mielleuse des Walker Brothers, et portait l'esprit contestataire au-delà des cercles universitaires politisés amateurs de chansons folk. Ses chansons ne suscitaient pas l'engouement, mais elles surprenaient car elles allaient à l'encontre de toutes les conventions. Elles n'étaient pas faites pour être consommées mais pour qu'on prête attention à leur poésie et à leur message. La poésie de Dylan faisait le lien avec l'œuvre des écrivains de la génération beat comme Kerouac et Burroughs qui commençait à être connue. Le poète Allen Ginsberg servit de pont. Le folk éleva à son plus haut point la suprématie des paroles sur la musique et entraîna son auditoire vers la critique sociale. En rencontrant le rock, il le politisa, le transformant en outil de contestation.
La crise sociale en cours aux États-Unis restait larvée dans l'Europe en reconstruction, bien qu'elle donnait des signes de vie plus qu'évidents. En ce qui concerne le Royaume-Uni, les romans Absolute beginners de Colin McInnes, La Solitude du coureur de fond d'Alan Sillitoe et Baron's court, all chance de Terry Taylor sont une meilleure introduction aux sixties que n'importe quelle analyse sociologique. L'abondance de travail procura de l'argent aux jeunes des banlieues qui prenaient plaisir à le dépenser en vêtements, chaussures, motos et disques de blues, rhythm'n'blues, soul et rock'n'roll. La consommation, aidée par la télévision qui remplaçait la radio dans la communication de masse, s'étendit aux adolescents. Les musiciens noirs, encore discriminés dans leur pays, aimaient se rendre en Angleterre où ils étaient traités comme des génies tandis que les groupes musicaux les appuyaient et cherchaient à les imiter. Lors de sa mue, le rock avait laissé derrière lui ses racines rurales et était devenu entièrement urbain. En 1963, un de ces groupes, les joyeux et sympathiques Beatles se transforma du jour au lendemain en un phénomène de masse encore jamais vu auparavant que les médias appelèrent "beatlemania". Le précédent le plus proche, Elvis, était largement dépassé. Des singles aux paroles simplettes comme "Please, please me", "She loves you" ou "I want to hold your hand", tous sortis la même année, se vendirent en quantités inimaginables. L'année suivante, un autre groupe, pourvu d'une image débraillée et agressive, les Rolling Stones, jeta de l'huile sur le feu. Leur musique était plus dure, leurs paroles plus provocatrices, leur attitude davantage contraire aux bonnes manières. Si les Beatles représentaient le Ying du rock britannique, les Stones étaient le Yang. Les fans des premiers étaient des étudiants de secondaire, des teenagers accros à la mode, aux revues illustrées et aux émissions de télé, s'entassant par milliers au passage de leurs idoles et criant comme des possédés, ce qui stupéfiait vraiment le monde. Le spectacle de masse de gamins hystériques était trop tentant pour un média comme la télévision; un reportage sur ce sujet eut une grande répercussion aux États-Unis entraînant la visite des Beatles. En février 1964, leur participation au show d'Ed Sullivan fut regardée par 74 millions de personnes, soit la moitié du pays. La porte était désormais ouverte pour tous les groupes : d'abord les Rolling Stones, puis les Animals, les Yardbirds, les Kinks, les Who, les Hollies, Spencer Davis, Them et tant d'autres commencèrent à débarquer de l'autre côté de l'Atlantique révolutionnant la façon de jouer et de penser avec leur réinterprétation de la musique noire. Par ricochet, les portes britanniques et européennes s'étaient ouvertes pour des bluesmen géniaux pratiquement ignorés en Amérique du fait qu'ils étaient noirs, comme John Lee Hooker, Sonny Boy Williamson, Howlin’ Wolf, Muddy Waters, Willie Dixon, etc. Tous les groupes anglais considéraient un honneur de jouer aux côtés de maîtres aussi inégalables sans lesquels ils n'auraient littéralement jamais existés (les Rolling Stones qui devaient déjà leur nom à un thème de Muddy composé par Dixon, enregistrèrent leur deuxième ou troisième album chez Chess Records en 1964, et ils choisirent B.B. King - celui qui appelait toutes ses guitares "Lucille" - comme première partie de leur tournée américaine de 1969. Pendant ce temps, la musique pop britannique recevait un appui soutenu dû aux efforts du conservatisme des dirigeants des médias pour enrayer l'avancée du rock. Ceci entraîna l'apparition de radios pirates installées dans des bateaux qui émettaient du rock vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le meilleur exemple fut peut-être Radio Caroline, née en mars 1964. Trois ans après, dans un cadre assez différent, celui de "L'Été de l'amour" de San Francisco, Californie, apparaissait la première "radio libre", expérience vouée à une longue destinée.
Celle que l'on appela "Invasion britannique" déclencha une vague de groupes de "garage" qui pour la première fois avaient un public, et donc un marché. Le rock retournait à ses origines contestataires donnant une voix aux dissidents. Le succès d'une chanson comme "Satisfaction" n'a pas d'autre explication. Deux détails extramusicaux y contribuèrent. Vers l'Europe, la consommation de haschisch, plante médicinale qui favorisait la sociabilité; les Beatles fumèrent leur premier joint dans un hôtel de New York invités par Dylan. Vers l'Amérique, les cheveux longs; c'était ce qui scandalisait le plus les Américains partisans de l'ordre, jusqu'au point que les crignères seraient aux Blancs rebelles ce que la peau était aux Noirs, comme l'affirmait Jerry Rubin dans Do it ! Il y avait aussi un mauvais côté à tout cela; le rock avait poussé l'industrie culturelle vers de nouveaux sommets, générant de grands bénéfices et obtenant la reconnaissance des hiérarchies, symbolisée par l'octroi aux Beatles de la médaille de l'ordre de l'Empire britannique. En Europe, le rock ne s'affranchira jamais des impératifs commerciaux, mais il en était autrement aux États-Unis, place privilégiée de la révolte contre la société de consommation.
De nouveau en route (On the road again)
La marche vers Washington en août 1963 en faveur des droits des Noirs eut une telle répercussion qu'en moins d'un an, malgré l'assassinat du président Kennedy, une loi fut approuvée qui sur le papier mettait fin à la discrimination raciale. Cependant, la discrimination économique et sociale se poursuivait, protégée par la police blanche ainsi que le dénonçait le prédicateur Malcolm X, assassiné en février 1965, ou comme l'illustrèrent les émeutes de Watts en août de la même année, qui inspirèrent une chanson à Frank Zappa, "Troubles comin' every day", dans laquelle les non-Noirs étaient ulcérés d'être Blancs, chanson publiée ensuite dans l'album Freak out! des Mothers of Invention. Le besoin de se défendre conduisit à une radicalisation des Afro-Américains avec la création en octobre 1966 du Black Panther Party. La renaissance de l'orgueil noir et les nouvelles tactiques d'autodéfense influencèrent énormément les rebelles blancs des années soixante. D'autre part, la lutte en faveur des droits était renforcée par l'opposition à la guerre du Viêt Nam. En se rebellant contre la guerre, les jeunes protestaient contre la société qui l'avait provoquée, dénonçant les intérêts de classe qui se cachaient derrière elle. Les exigences d'égalité des races, paix, dialogue libre, dépénalisation des drogues ou de sexualité sans entraves combattaient une morale hypocrite conçue pour défendre l'inégalité, l'exploitation, l'autoritarisme politique et la famille patriarcale, bases du système. Si l'anarchisme et le marxisme dans leurs versions multiples ne suffisaient pas pour expliquer la révolte moderne, en revanche le bouddhisme zen préconisé par des automarginalisés sociaux non-violents que l'on commençait à appeler hippies - dans le sens de bohémiens, suiveurs de la tradition beat et lecteurs d'Alan Watts - offrait des manières de décrocher du système, intérieurement et extérieurement, tout en cherchant l'harmonie avec l'univers, manières qui ne collaient pas bien avec l'idée de révolution prônée par lesdites idéologies.
Cette contradiction pouvait se maintenir au moment de la montée de la crise, lorsque son aggravation était supposé conduire à des perspectives théorico-pratiques moins confuses et plus efficaces. L'expansion du maoïsme, le fanonisme et le guévarisme, produit de l'identification des contestataires avec les faux ennemis du système, à savoir, la Chine communiste, le régime de Castro et les mouvements de libération nationale, se chargerait d'empêcher que la confusion se dissipe. Des musiciens comme Country Joe tombèrent dans le piège, prenant ce nom en honneur au nom de guerre utilisé par Staline; ou comme Joan Baez qui rendit hommage à La Pasionaria, la pire vermine stalinienne; mais d'autres surent les éviter, par exemple, l'ironique Frank Zappa qui se référait aux gauchistes et aux droitistes comme des gens "prisonniers de la même étroitesse mentale, superficielle et aphone." Par ailleurs, pour un grand nombre, l'expérience spirituelle dépassait l'expérience politique. Pour la même raison, la libération sociale se limitait à "libérer l'esprit" comme l'avait indiqué William Blake dans "Le Mariage du ciel et de l'enfer", poème mentionné en 1954 par l'essayiste Aldous Huxley : "Si les portes de la perception étaient nettoyées, chaque chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, infinie." La lecture du livre de Huxley sur ses expériences avec le peyotl, The Doors of perception, amena Jim Morrison à appeler son groupe "Les Portes". Le même Morrison commenta l'impulsion qui le poussa à explorer ce qu'il entendait par limites de la réalité : "Je pensais que tout était une grande farce, quelque chose dont on pouvait rire. Je connaissais quelques personnes qui étaient en train de faire quelque chose, qui essayait de changer le monde. Je voulais me joindre au voyage". La marijuana, l'acide lysergique, la mescaline et les mantras se prêtaient davantage à ce genre de changement libérateur entendu comme un "voyage" mental que les méthodes classiques d'agitation. C'est pourquoi la bonne ambiance rituelle des festivals était préférable aux marches de protestation. La presse contre-culturelle parlait d'un "nouveau concept de célébration" émergeant de l'intérieur des personnes de telle façon que la révolution pouvait se concevoir comme "une renaissance de la compassion, la conscience, l'amour et la révélation de l'unité de tous les êtres humains." Le rock prit ce chemin. Le LSD, encore légal, popularisé par Timothy Leary, les Merry Pranksters de Ken Kesey (l'auteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou) et Neal Cassady (Dean Moriarty dans Sur la route), produit en grande quantité et distribué gratuitement dans les grands rassemblements festifs hippies, fut le véhicule utilisé par musiciens et auditeurs, qui au début n'étaient guère différenciés dans cette ambiance communautaire. Les Grateful Dead, la mort qui annonce la renaissance - c'est pourquoi elle est reconnaissante - étaient le groupe des hippies par excellence. Dans Acid Test, Tom Wolfe décrit par la bouche d'un autre "l'étrange son des Grateful Dead ! Une agonie-dans-l'extase ! Sous-marine, trouble la moitié du temps, extraordinairement bruyante, mais comme si on était assis sous une chute d'eau pleine de vibratos genre spectacle de vampires, comme si les cordes des guitares électriques s'étendaient sur la moitié d'un pâté de maisons, et résonnaient dans une pièce emplie de gaz naturel, sans parler de leur grand orgue électrique Hammond, on dirait un juke-box de cinéma, une machine de diathermie, une radio locale et un camion de voirie qui broie ses ordures, vers quatre heures du matin, tout ça sur la même fréquence". Avec ironie, Eric Burdon dédia une chanson à Sandoz, la multinationale qui fabriquait l'acide (aujourd'hui Novartis). Le psychédélisme démarra avec "You're gonna miss me" du groupe garage 13th Floor Elevators, les premiers à utiliser ce terme pour définir leur musique faite à base d'hallucinogènes. À noter que le M de "marijuana" est la treizième lettre de l'alphabet. Cependant, la drogue ne pouvait pas figurer dans les paroles des chansons; ainsi, vers la même époque, un autre groupe pionier, The Charlatans, vit comment sa maison de disques rejetait sa version de "Codine" écrite par la chanteuse folk Buffy Sainte-Marie car les paroles évoquait l'addiction à la codéine. La nouvelle philosophie fut synthétisée par Timothy Leary dans la grande rencontre hippie de janvier 1967 au Golden Gate Park de San Francisco, le Human be-in, avec une phrase magique : "Turn on, tune in and drop out" ("Connecte-toi, syntonise et oublie le reste").
L'acide fut l'ingrédient qui permit de fusionner rock, folk, blues, soul, free jazz et country, produisant ainsi la musique de la révolution américaine. Elle expulsa la négativité de la classe moyenne urbaine frustrée, donnant aux fugitifs du bien-être une vision positive du futur, certes simpliste, mais qui semblait fonctionner dans des collectifs homogènes pas trop grands qui parasitaient les restes de l'empire. Le radical yippie Abbie Hoffman, dans son ouvrage explicitement intitulé Volez ce livre, fit le compte-rendu de centaines d'expériences alternatives fonctionnant en dehors des circuits de l'argent. Les musiciens, britanniques comme américains, cherchèrent de nouvelles sonorités pour exprimer les états inexplorés de l'esprit. Pour les exprimer, les chansons de deux ou trois minutes étaient inutiles, de même que les petits disques de 45 tours; les grands 33 tours étaient plus appropriés. En 1966 parurent "Good Vibrations" des Beach Boys en tant que partie d'un LP inachevé; "Paint it black", dans la version américaine de l'album Aftermath des Rolling Stones; et le LP des Beatles Revolver, ces derniers, voulant donner une image moins frivole avaient abandonné leur ligne pop et renonçaient à donner des concerts. La technologie contribua assez à l'expérience sonore. Les studios d'enregistrement permettaient toutes sortes de mixages. Les boîtes appelées pédales, car elles s'allumaient et s'éteignaient avec le pied, créaient de nouveaux effets de guitare, soit en modulant le son comme la wah-wah, soit en le distortionnant comme la fuzz. "Voodoo chile" et "Purple haze" de Jimi Hendrix en sont deux exemples. Le mellotron, prédécesseur des samplers, permettait de reproduire par un clavier des sons enregistrés sur bande au préalable (les trompettes de "Strawberry fields forever" sont de son fait). Nous pourrions ajouter à la liste divers instruments tels que violons électriques, guitares à douze cordes, claviers divers, thérémine, banjo, sitar, bongos, bouteilles, etc., qui apportèrent leur grain de sable à la création du rock psychédélique. Lothar and the Hand People, groupe qui avait composé un insolite "Space hymn", alla jusqu'à considérer le synthétiseur Moog ("Lothar") comme son leader. La principale caractéristique du psychédélique était l'improvisation. Les chansons, interprétées en direct, dérivaient en de longs solos de guitare spontanés, traduisant une échappée sous acide de la vie urbaine névrotique qui absorbait la réalité quotidienne. Nous choisissons au hasard "Eight miles high" des Byrds, "The Pusher" de Steppenwolf, "East-West" du Paul Butterfield Blues Band, qui est un solo d'un bout à l'autre, "The End" des Doors et toutes les chansons de Grateful Dead en direct, de "Viola Lee Blues" à "Morning Dew". Nous pourrions citer aussi l'oppressant "Sister Ray" du Velvet Underground, mais ce groupe se situait à l'extrême opposé des hippies, appartenant à une mouvance pessimiste et autodestructrice qui avait remplacé l'acide par l'héroïne. Même si Canned Heat et Janis Joplin portèrent mieux que personne l'acide au blues, et les Jefferson Airplane résumaient mieux que personne l'esprit hippie avec des chansons accrocheuses comme "Somebody to love", les charismatiques Grateful Dead, groupe aux capacités musicales incroyables, furent le modèle de la création psychédélique et la musique par excellence du décrochage généralisé de cette fin de décennie. Les écoutant en ces jours-là, on comprenait que sans le rock la vie aurait été une erreur.
Nous sommes les volontaires d'Amérique (We are volunteers of America)
San Francisco, et particulièrement le quartier de High Ashbury, semé de mansions délabrées où résidaient plusieurs groupes connus, devint le pôle d'attraction hippie. John Phillips, de The Mamas & the Papas, composa pour Scott McKenzie une chanson qui commençait par "Si vous allez à San Francisco, assurez-vous de porter des fleurs dans les cheveux", saisissant à la perfection la béatitude de ce moment. Les autorités locales s'alarmèrent devant la possibilité d'une invasion de vagabonds et de bohémiens freaks, c'est pourquoi une trentaine de collectifs contreculturels entre lesquels figuraient la commune Family Dog, les Diggers, The Straight Theatre et le journal underground San Francisco Oracle, aidés par des églises, organisèrent un Été de l'Amour où tout serait gratuit : musique, nourriture, acide, assistance médicale, habits, sexe... Le festival Monterey Pop attira les foules. San Francisco se remplit d'adolescents fugueurs, de curieux, de paumés sans point d'attache, d'obsédés, de trafiquants, de voyous, de profiteurs... Le succès de cet été avait dépassé les prévisions les plus optimistes, menaçant l'existence de la communauté de High Ashbury jusqu'au point de devoir forcer en octobre un "Enterrement du hippie", célébration où l'on recommenda vivement aux je-m'en-foutistes de rester chez eux et à faire la révolution dans leurs villages parce que à San Francisco c'était fini. Ce fut le tour des Flower Children, ces fils des classes aisées qui les week-ends portaient des chemises à fleurs aux couleurs criardes et se mettaient des rubans dans les cheveux. Les Seeds leur écrivirent une marche. Le style hippie se transforma en mode et les freaks abandonnèrent la ville pour laisser place aux touristes. La musique perdait son âme, retournant au divertissement. Les concerts commencèrent à être payants. La contreculture, gratuite et désordonnée, devenait un produit étudié pour la consommation. L'industrie du spectacle accumulait davantage de pouvoir, recrutant dans les groupes les meilleurs artistes pour en faire des pop stars à coup de chéquier. Si Surrealistic Pillow des Airplane représentait le côté face du psychédélisme, son message libre, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles en était le côté revers, son officialisation bien rémunérée. Les Mothers of Invention imitèrent grotesquement la pochette dans un LP intitulé We're Only in It for the Money ("Nous n'y sommes que pour l'argent"). Nous aurions été plus indulgents si les Beatles n'avaient pas accepté la commande de la BBC d'écrire une chanson avec tous les poncifs floraux, "All you need is love", diffusée pour la première fois au monde via satellite. C'était un sale temps pour la paix et l'amour véritable; les faucons qui souhaitaient attiser la guerre au Viêt Nam n'étaient pas impressionnés par les psalmodies hippies. Mais les déserteurs s'organisaient, les minorités raciales se défendaient l'arme au poing, tandis que se succédaient marches sur le Pentagone, défilés à Wall street et occupations d'universités, démonstrations initialement pacifiques qui se terminaient en affrontements violents avec la police. En 1968, la non-violence perdait du terrain, se contentant de suivre les événements au lieu de les précéder. Les rues étaient en effervescence. En mars, une immense manifestation contre la guerre dans le Londres pacifique face à l'ambassade américaine se termina par le matraquage de manifestants. Les Stones sortirent un single, "Street fightin' man", avec une image des agressions policières sur la pochette. La pochette de l'album d'où il était tiré, Beggars banquet, sur laquelle apparaissait une cuvette de WC avec des inscriptions offensantes sur le mur, fut également censurée. Digne parure de celle qui fut sans doute la meilleure chanson de la décennie, "Sympathy for the devil", fille bâtarde des Fleurs du mal et de Le Maître et Marguerite, de Baudelaire et Boulgakov; ce dernier publié de façon posthume en 1966, tournait en dérision la paranoïa bureaucratique du régime stalinien qui avait réduit Boulgakov au silence de son vivant. Les Stones furent le seul groupe qui prêta attention à Mai 68, et évidemment, ce mois-là ne fut pas un thème du répertoire rock.
Aux États-Unis, une patrouille de la police routière avait tiré de manière indiscriminée à Orangeburg, Caroline du Sud, sur une manifestation d'étudiants noirs, en tuant trois et en blessant vingt-huit autres. Martin Luther King fut assassiné par un tireur embusqué. Le FBI commençait son travail criminel destiné à en finir avec celui qui fut désigné ennemi numéro un de l'État, le parti des Black Panthers. Avec autant de morts, la tactique non-violente avait du plomb dans l'aile. Beaucoup considéraient que le système ne pouvait être changé de gré, et ils envisageaient le faire de force. Toutefois, le mouvement contre la guerre joua sa dernière carte à Chicago, ville où devait se réunir en août 1968 la Convention du parti démocrate pour choisir le candidat présidentiel. Les radicaux convoquèrent une concentration de type festif. Graham Nash, du groupe C, S, N & Y, écrivit après coup une chanson sur l'événement. La diffusion de "Street fightin' man" fut interdite par crainte d'incidents, même si personne n'avait fait appel à l'affrontement. Comme à l'accoutumée, on comptait sur la répercussion médiatique des actes alternatifs comme instrument de pression politique. Plusieurs groupes s'étaient engagé à participer, mais finalement seuls jouèrent ce jour-là les MC5, atout du parti des White Panthers, qui considérait le rock comme une arme révolutionnaire. Norman Mailer couvrait l'événement pour Harper's Magazine et William Burroughs pour Esquire. Au début, tout se passa tranquillement; on présenta comme candidat le cochon Pigasus au milieu des rires et du brouhaha, mais le zèle répressif du maire démocrate fit que les choses s'envenimèrent et que la guerre à la guerre finisse en combat de rue. Il y eut de nombreux blessés et arrestations, les radicaux les plus connus furent poursuivis. En novembre, Richard Nixon remportait les élections ce qui laissait prévoir un durcissement répressif et une tolérance zéro non seulement envers le radicalisme, avec les assassinats de militants Black Panthers, mais aussi envers des conduites véniellement transgressives, comme le montrait la condamnation de John Sinclair à dix ans de prison pour possession de deux joints. C'est dans ce contexte agité que fut annoncé le festival de Woodstock qui devait se tenir en août 1969, dans l'état de New York, avec une liste impressionnante de groupes. Un demi-million de personnes assistèrent au festival, beaucoup plus que ce qui était prévu. L'organisation fut chaotique, il pleuvait sans arrêt et certains, comme les Motherfuckers ("une bande de rue avec de l'analyse"), se fâchèrent lorsqu'on voulut leur faire payer l'entrée. Ils brisèrent les clôtures et tout le monde put occuper son bout de terrain boueux. Les pertes seraient épongées avec le disque et le film. Les radicaux distribuèrent de la propagande, parlèrent de paix et d'amour, et réclamèrent la libération de Sinclair; tout cela avec un air de déja-vu. Jimi Hendrix "déconstruisit" l'hymne américain devant un public endormi. Woodstock représentait le nouveau conformisme de la jeunesse américaine, composée en majorité de Blancs sans problèmes économiques, uniquement capable de rester calme, extasiée, passive, face à des musiciens transformés en stars pour lesquels elle sentait une dévotion fétichiste, avec la bonne conscience qu'il suffisait d'être présent; l'entassement passait pour de la fraternité et la défonce, pour une libération. Pour rien au monde elle ne voulait s'engager, ni participer à quelque chose de plus consistant. Woodstock reproduisait la séparation spectaculaire entre public et acteurs, entre réalité et image, l'une aussi vide que l'autre est rentable. Ce n'était rien d'autre qu'une somme de performances dont le degré subversif était nul dans une ambiance de rébellion stéréotypée, une ruine en apparence qui donnerait lieu à un substantiel jackpot. Comme pour confirmer la vision pessimiste du film de l'année, Easy Rider, dirigé par Dennis Hopper, où à la fin les hippies protagonistes sont abattus par des Américains "profonds". Une dérive qui finit mal. Prémonitoire. En septembre eut lieu le procès des "Huit de Chicago", pour conspiration et incitation à la violence. Le procès suscita un grand intérêt et Nixon envoya la Garde nationale pour contrôler les manifestants sous la menace des armes. Devant le tribunal, les accusés saisirent l'occasion pour retourner les accusations et ridiculiser le système judiciaire américain. Bobby Seale, dirigeant des Black Panthers traita le juge de "cochon fasciste"; il le fit juger séparément et le condamna à quatre ans de prison pour outrage. Les autres accusés, faute de preuves crédibles, s'en sortirent bien. Le même mois, l'apôtre du LSD Timothy Leary poursuivait son défi contre le gouvernement américain en se présentant au poste de gouverneur de Californie face à l'ultraconservateur Ronald Reagan. Pour son extravagante campagne, les Beatles composèrent "Come together". La chanson fut boycottée par la BBC car les censeurs pensaient que la phrase "He shoot Coca Cola" faisait allusion à la cocaïne. Leary, qui rejetait les narcotiques, fut condamné à dix ans d'emprisonnement pour le sachet de marijuana découvert lors d'une fouille.
Ceci est la fin, mon ami, la fin (This is the end, this is the end, my friend)
Comme il n'y a pas deux sans trois, quelques malins voulurent répéter le coup de Woodstock sur la côte ouest. La police de San Francisco avait blindé la ville contre les festivals, c'est qui fait que le lieu choisi pour la tenue du Speed free festival fut Altamont, au nord de la Californie. Les Rolling Stones servirent de réclame pour cette nouvelle célébration dont le service d'ordre devait être garanti par les Hell's Angels, une bande de motards tout à fait opposée à la mouvance hippie. Ni les assistants au concert, ni les Hell's Angels restèrent tranquilles. L'alcohol mélangé aux amphétamines, une substance psychotrope qui provoque l'hyperactivité, surpassa l'acide et tout cela dégénéra en avalanches et en bagarres, où musiciens et public furent tabassés à parts égales. Quatre morts certifièrent la fin de la "nation Woodstock" seulement quatre mois après son apparition. À Altamont, la masse consommatrice ne se supportait même plus elle-même, et dans son hystérique perte de contrôle elle endura l'intempérance d'un service d'ordre qui exerçait sa fonction de la même façon que l'aurait fait la police. Ce ne fut pas le pire jour du rock, ce fut la mort du rock tel qu'il avait été jusque là. Il était en train de devenir une composante de plus de la culture de masse et un véritable business capable de tirer profit de n'importe quelle situation. Lorsque le 4 mars 1970 la Garde nationale ouvrit le feu sur les étudiants universitaires de Kent (Ohio) en tuant quatre, le cycle de la révolution américaine se conclut. Neil Young, de C, S, N & Y, composa une chanson sincère de protestation intitulée "Ohio". Ce fut un succès qui ne servit à rien; les assassins ne furent pas inquiétés. Young signalait avec tristesse que finalement les morts malheureuses en question n'avaient fait que lui rapporter de l'argent. Le 15 mai de la même année, la police tira sur les étudiants de l'Université d'État de Jackson, Mississippi, qui protestaient contre l'invasion américaine du Cambodge, tuant deux jeunes et en blessant quatorze. Et le 10 juin, après des mois de tumulte, la police envoyée par le gouverneur Reagan chargeait brutalement les étudiants de l'Université de Californie, à Santa Barbara, lors d'une manifestation au Perfect Park d'Isla Vista contre l'imposition de la loi martiale dans cette zone, principal foyer du radicalisme. Il y eut des centaines d'arrestations après de violents affrontements. Un groupe de plage BCBG, que les drogues avaient rendu meilleur, transforma "Riot in Cell Block Nine" en une chanson consacrée aux révoltes, "Student Demonstration Time", mais sans la moindre répercussion : une année s'était écoulée, la chanson ne sortit pas en single et puis... il s'agissait des Beach Boys ! Groupe qui avait débuté avec une conversion de signe contraire en transformant "Sweet little sixteen" de Chuck Berry en l'écœurant "Surfin' USA". Le show business et l'industrie discographique avaient dépassé en audace les contestataires (certes, les forces de l'ordre et les drogues dures aplanissaient le chemin.) Le même mois de juin, le Summer Pop Festival de Cincinnati, également dans l'Ohio, lança des groupes précurseurs, comme The Stooges ou Grand Funk Railroad. En août 1970, il y eut une tentative visant à retrouver la "magie" de Woodstock à Goose Lake (Michigan) à laquelle donna crédibilité la présence des White Panthers et de la coalition STP - Serve the People ou Stop the Pigs, selon les préférences - œuvrant pour la libération de Sinclair et de tous les prisonniers politiques. Le jour choisi ne fut pas un hasard; c'était le vingt-cinquième anniversaire des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, donc l'idée sous-jacente était antinucléaire. Mais il s'agissait plus d'un ornement et d'un prétexte que d'un vrai message. À l'affiche, des groupes vétérans et nouveaux, tous blancs, parmi lesquels il faut souligner, mis à part la présence des groupes belliqueux de Detroit, le groupe Chicago et Ten Years After qui jouèrent devant une multitude de 200'000 personnes, la plupart défoncées, qui donnèrent peu de travail à un service d'ordre amical. La présence du cheval fut notoire; les drogues comme l'héroïne étaient les mieux indiquées pour une unification virtuelle de tout ce qui en réalité demeurait séparé. Étrangement, les dealers qui s'en donnèrent à cœur joie, ne furent pas inquiétés par la police. Même pour les moins lucides, il y avait un arrière-goût amer de cirque, de ghetto, de trafic, qui marquait sans le moindre doute la fin d'une époque. Les festivals se poursuivirent, à Toronto, sur l'île de Wight et ailleurs, sans que la domination ne bronche. Ce n'était pas que le Pouvoir cédait du terrain devant une troupe disposée à ne pas batailler, c'était juste qu'il apprenait à se moderniser. Les hallucinogènes étaient pour beaucoup le seul moyen de se défaire des valeurs inculquées par le système, le chemin de l'union de l'individu libéré et conscient de son être profond avec le cosmos; le système semblait le penser aussi puisqu'il punissait avec acharnement leur utilisation.
Mais, dès lors que le système changeait de valeurs et adoptait celles de ses critiques, les drogues changeaient de fonction : elles formaient partie d'un mécanisme d'évasion, aussi bien les opiacés que les amphétamines, les plantes et les champignons sacrés des Indiens. Toutes obéissaient à un désir pervers d'ébriété, non de conscience, elles étaient donc un instrument de réadaptation. Le drop out était une invitation à oublier les conventions, mais cela débouchait sur la passivité, non sur la transformation révolutionnaire de la société. Le cadre du festival, tolérant avec les stupéfiants, servait de soupape, cérémonial du je-m'en-foutisme apprivoisé, pause relaxante entre deux moments de soumission. D'un côté l'interprète, de l'autre le public drogué, et au milieu les gorilles. Le public défoncé se limitait à reproduire des schémas stéréotypés de rébellion virtuelle, anticipant ainsi des modèles d'intégration aux marchands fûtés de la culture.
La société industrielle avancée commençait à pratiquer un laissez-faire qu'elle appelait tolérance, plus propice à ses intérêts. C'était le genre de tolérance répressive que favorisait la tyranie de l'appareil car elle correspondait à la nécessaire transition capitaliste du conservatisme à la permissivité. La société de consommation n'est pas ascétique et régulée, mais hédoniste et transgressive. Avec une vitesse inusitée, la société spectaculaire de marché adoptait finalement une morale laxiste et utilitaire plus en accord avec le développement économique et ne se scandalisait de rien. Elle ne respectait même pas les morts : les cadavres de Brian Jones, Keith Moon, Janis Joplin, Jimi Hendrix ou Jim Morrison furent impitoyablement mythifiés. Vivre vite, mourir jeune et faire un joli poster. Le système était également monté dans le wagon du rock, de la méditation transcendantale, de la psychanalyse, du sexe et de la marijuana, et il n'avait guère de peine à supporter les messages désenchantés et le comportement histrionique et autodestructeur des nouveaux rockers impliqués dans une musique rude et fracassante. Des chansons comme "TV Eye" d'Iggy Pop ou "School's out" d'Alice Cooper ne réveillaient plus la censure. Le système, jusqu'à un certain point, laissait faire. Il n'y avait pas de futur, de futur révolutionnaire s'entend. Il y eut bien des événements qui révélèrent le vrai visage de ce fascisme latent présidé par Nixon comme l'assassinat de George Jackson, un des "Soledad Brothers", aux mains des gardiens de la prison de San Quentin le 21 août, et le massacre des mutinés de la prison d'Attica planifié par le gouverneur Rockefeller un jour de septembre 1971. Dylan enregistra à la guitare acoustique deux versions de son "George Jackson", single qui ne figurera sur aucun album. Tom Paxton écrivit "The Hostage", chanson narrative dans la meilleure veine folk consacrée aux événements d'Attica. Et le même John Lennon sortit une ritournelle agréable baignée d'un pacifisme dépassé, idéale pour les inconditionnels. Il se peut que les temps n'étaient plus à la chanson, mais avec des centaines de militants qui s'inscrivaient à la guérilla urbaine, il est certain qu'ils n'étaient pas disposés à écouter des discours bon enfant du style "allons ensemble avec le mouvement, prenons parti en faveur des droits de l'homme". La phrase dylanesque de "Subterranean homesick blues" était plus opportune : "Pas besoin d'un monsieur météo pour savoir d'où souffle le vent". En effet, "Weathermen" fut le nom choisi par la plus grande organisation armée nord-américaine des années soixante-dix.
Plus on s'élève et plus dure sera la chute. Signe du changement d'époque, le début des années soixante-dix voit les groupes les plus authentiques arriver au zénith de leur créativité en pleine contre-révolution, produisant des œuvres qui agressaient le goût des masses modérément rebelles qui les avaient porté au sommet, avant de se décider à faire partie de la "majorité silencieuse" de Nixon et Agnew. Plusieurs groupes refusaient le rôle d'idole reflétant les nouvelles valeurs conformistes, ce qui les conduisaient à la dissolution (Beatles, Doors) ou à la copie d'eux-mêmes (Temptations, Sly and the Family Stone). Les Stones après Exile on Main street ne cessèrent de se répéter. D'autres se relâchaient, faisaient marche arrière ou s'épuisaient (The Band, Byrds, Kinks, Who) sans que certains ne se dispensent de laisser à la postérité une ennuyeuse et prétentieuse "opéra rock". Finalement, il y en eut qui optèrent pour des changements de style invraisemblables; c'est le cas des Jefferson Starship, les restes honteux du naufrage d'Airplane. D'un autre côté, le rock légitime, celui que pouvaient représenter Captain Beefheart, Tom Petty, Lou Reed, Patti Smith ou les Ramones, par exemple, était devenu minoritaire et progressivement dépolitisé. Dans un contexte destroy, nihiliste et coléreux, où le Chaos était l'objectif le plus séduisant, le mot "hippie" prit une connotation de vétusté, d'idiotie et d'impuissance. Hors quelques cercles restreints de résistants, le rock avait perdu son aura et, soit qu'il s'engageât soit qu'il se prêtât à l'évasion, il devenait prévisible et routinier, sophistiqué et lourd; une musique décadente conçue par des narcisses pour distraire une jeunesse onaniste qui réclamait sa dose d'aliénation symphonique ou autre. Une musique, d'une certaine façon, optimiste qui tranquilisait et relaxait, ainsi que le souhaitait le nouvel ordre. Les innovations techniques des années soixante-dix comme les samplers, synthétiseurs et boîtes à rythmes engloutirent la guitare, la basse et la batterie. "Family Affair" de Sly Stone fut la première chanson sortant d'une de ces boîtes, chose qui devint habituelle peu d'années après avec la musique disco. D'autre part, le rock nouveau était moins de la musique que du cirque : il établissait avec son public une relation médiatisée par l'image et le glamour. La vedette dépendait plus du coiffeur, du garde-robe et de la télévision que de son talent. La séparation est la règle du spectacle, qui se perpétue dans la communion béate avec l'image de l'"idole", que ce soit à travers le shock scénique ou à travers du get high avec les drogues. Le vidéo-clip promotionnel prit de l'importance dans le domaine privé; en direct, on révolutionna la mise en scène au moyen d'effets divers, logotypes, jeux de lumières, effets pyrotechniques, fumigènes, projections, grues, passerelles, plates-formes, choréographies... Le "fan" devint le parfait animal domestiqué. Le bruit assourdissant des équipements, de plus en plus puissants, combiné avec les lignes de coke, les pastilles et l'eau minérale parvenait à provoquer chez lui une espèce de frénésie autiste, la forme onaniste de la passivité. Cette auto-agitation masochiste se généralisa avec la renaissance des discothèques, plus grandes et mieux conçues, qui donnèrent le coup de grâce à la musique en direct dans les pubs, théâtres et autres salles. Un genre de musique facile et répétitif émergea et fit fureur, organisée par un nouveau maître de cérémonie, le disc jockey. Les paroles et les accords se réduisirent à leur plus simple expression. Le rythme fut simplifié au maximum et occupa l'espace de la mélodie qui dégénéra en jingle. Un nouveau support audio comme la cassette promettait de démocratiser l'enregistrement le rendant accessible à n'importe quel groupe, mais ce ne fut pas le cas parce que la musique pop avait changé de fonction. La créativité n'était plus qu'un détail; désormais la pop remplissait le vide d'une vie déterminée par les impératifs de la consommation. Le résultat final était toujours le même : le conformisme. En réalité, la cassette accentua la privacité et le cocooning, amenant cette musique là où ne pouvait le faire le vinyl, en particulier l'automobile, prothèse de l'individu moderne aliéné et symbole de sa puissante impuissance. Les publics se fragmentèrent, les marchés se diversifièrent selon la tranche d'âge et le type de consommateur. Ce fut l'apothéose de l'hédonisme de la marchandise : de la fête, du fun, de la pose cool, des allures branchées. En résumé, l'épiphanie complète du spectacle. L'authenticité se payait par la marginalisation. Là était la force de la société de masse. Aucune option ayant des prétentions de véracité ne pouvait échapper au cercle limité dans lequel elle s'inscrivait, succombant dans la répétition et la banalité aux mains de ses partisans transformés en tribus urbaines. C'est ce qui arriva avec le heavy metal, le reggae, le punk. Le rock ne servait plus de digue contre la barbarie modernisée : c'était un genre fini, un moyen stéril, un fantôme, une relique, une arnaque. C'était désormais la musique de l'autre camp. Il n'existait que parce que de nombreux intérêts en jeu étaient nés à l'ombre de l'industrie de l'évasion. La révolution et le divertissement ne marchaient plus ensemble, l'une perdant sa dimension ludico-populaire, et l'autre son caractère subversif. On peut mieux comprendre les échecs des mouvements révolutionnaires d'alors en prêtant attention à la régression du rock qui traduisait la victoire de la culture-spectacle et la dissolution des classes dangereuses dans les masses consommatrices. Certes, tous ses éléments basiques étaient déjà présents dans les années soixante, mais ce fut lors de la décennie suivante qu'ils se développèrent exponentiellement et sans entraves. Depuis, de nombreux styles musicaux aux intentions plus ou moins louables, et avec des fortunes diverses, ont fait parler d'eux. Aucun n'a dépassé son ghetto particulier, car aucun n'a réussi à exprimer les espoirs universels de liberté et d'autoréalisation comme le rock de cette époque; aucun n'a autant enseigné à désapprendre, ni n'a défié aussi efficacement l'ordre, ni n'a encouragé aussi longtemps la protestation.
Miguel Amorós, Rock para principiantes

Sans valeur marchande : https://debord-encore.blogspot(...).html
La peste citoyenne. La classe moyenne et ses angoisses : http://parolesdesjours.free.fr(...)e.pdf
La peste citoyenne. La classe moyenne et ses angoisses : http://parolesdesjours.free.fr(...)e.pdf
