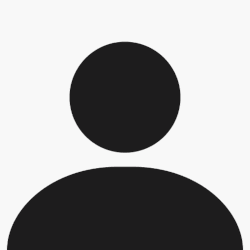Zorzi a écrit :
Une nouvelle compo, ça faisait longtemps
Toujours sans guitare parce que cet instrument marque un champs trop défini, celui du blues et dérivés en fait et comme j'ai envie d'autre chose…
Ah, Antoine,
Antoine, tu me déranges.
Tu me déranges
avec toute cette beauté
plus son pouls infini
dont je suis assoté
et qui m’acoquine, enfin,
à retrouver geste comme parole.
Alors, je découche.
Je découche de mon silence en chantage et
me dérange, pour toi,
tout l’opus tout
à l’oreille de ton Guerrier,
au-delà de ta centaine, si singulière,
son étrange rumeur
dans toute sa vérité,
et ses voix en chantier.
Le rêve allongé à l’ombre des coquelicots,
leur rythme, avec hauteur,
creuse à cette estime leur exemple froissé dans le bleu du ciel.
Plus loin, à peine, par manie et par ruse ourdie
autant pour moi,
au temps pour eux,
le guerrier assourdi à deux pas,
et ses quelques pavots de côté droit,
dansent dans le soleil
avec leurs ombelles noires ensommeillées
juste sous les pavés de l’horizon,
contre la grille aux petits traits noirs des secondes en synthèse
qui s’avancent dessous
le nuage de son, ou celui du détroit
—mais, pourras-tu choisir ?—
avec leurs pavois de cris,
l’autre rumeur des ombres grises
où
«les coups profonds du fer faisaient presque silence».
À cette fin, Antoine,
si fantaisie t’en prend, n’oublie pas,
non plus,
pour ma fanfare menue, au moins,
de saluer au passage
la
Crocevia dei Cedri et ses fantômes
en amazone,
corps et chœurs sis aux guêpes de chrome,
«come il succo dei frutti caduti allora».
Puis, de grâce, prolonge en rêve aussi
ce bonjour d’un geste vers
quelques très fins danseurs
et danseuses plus sibyllines encore
que nous aimons sans la moindre déraison.
Qu’un jour ou l’autre
quelques bribes de foudre parmi ta grande centaine
t’échappent et leur tiennent
compagnie,
certains soirs,
entre le jardin et la cour.
Je retourne au silence et à son charbon.
Tu connais mes communes.
«Wir leben unter finsteren Himmeln, und –es gibt wenig Menschen. Darum gibt es wohl auch so wenig Gedichte. Die Hoffnungen, die ich noch habe, sind nicht groß. Ich versuche, mir das mir Verbliebene zu erhalten. »
Paul Celan, 18 mai 1960, Lettre à Hans Bender.