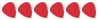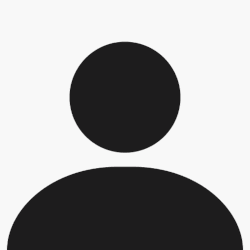Souvenir sacrément bien venu, Adam Do…
Dès l’adolescence, Colette Maze fut, et ce n’est de mon point de vue pas un hasard, l’élève de deux des plus grands professeurs de piano du XX°siècle, Alfred Cortot d’abord (aussi, accessoirement, soliste illustrissime), puis Nadia Boulanger (compositrice aussi méconnue qu’importante et profonde). Le premier incarnait la liberté presque créatrice de l’interprète (ah, Cortot et sa religion du rubato…) ; la seconde la rigueur de la partition (la liberté de l’interprète se cachant toujours, pour la grande Nadia, au creux des détails, dans la main et l’oreille presque clandestines que son élève prêtait à la rencontre de la vérité du texte –la partition– et du chant intérieur dont cet élève se faisait le porteur, presque à son insu pour devenir, pas à pas, un témoin, c’est à dire un interprète).
Colette Maze fut donc, à la source même, et juste avant la fin des années vingt de l’autre siècle, l’héritière de ces deux visions assez antinomiques.
C’est pourquoi, à son tour, elle eut largement le temps d’être aussi une très grande professeure de piano.
C’était, au surplus, une très juste et très belle interprète de Fauré et de Debussy, celui qu’elle joua sans doute le plus continûment tout au long de sa vie.
Jusqu’au souffle le plus récent, ce soupir suspendu qu’on ignore devoir être le dernier.
Aria da capo.
«Wir leben unter finsteren Himmeln, und –es gibt wenig Menschen. Darum gibt es wohl auch so wenig Gedichte. Die Hoffnungen, die ich noch habe, sind nicht groß. Ich versuche, mir das mir Verbliebene zu erhalten. »
Paul Celan, 18 mai 1960, Lettre à Hans Bender.