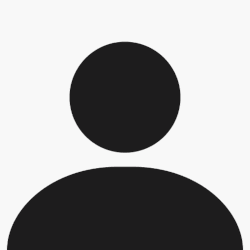Citation:
Remontant au paléolithique et à l’Antiquité, la philosophe Florence Burgat montre comment, du sacrifice à l’abattage industriel, les hommes ont choisi de maintenir une relation sanglante aux bêtes. Un problème métaphysique plutôt que nutritionnel.
«Pour se rappeler qu’elle s’est séparée des animaux, l’humanité les mange»
Florence Burgat
Pourquoi mangeons-nous de la viande ? Et pouvons-nous nous contenter de répondre à cette question en avançant : «parce que c’est bon» ? Dans l’Humanité carnivore (Seuil), Florence Burgat (photo DR), philosophe et directrice de recherche à l’Inra (Institut national de la recherche agronomique), interroge les soubassements anthropologiques et philosophiques de l’alimentation carnée. Loin de tout positionnement moral, et par delà la diversité des pratiques, elle croise les disciplines et les références pour livrer un ouvrage passionnant.
Du paléolithique à nos jours, de Porphyre à Derrida en passant par Lévi-Strauss, qui voyait le «carnivorisme» comme un «cannibalisme élargi», émerge cette question : derrière le prétexte culinaire et gustatif, l’humanité n’est-elle pas surtout attachée à une relation essentiellement meurtrière aux animaux ?
Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui semblent remettre en question leur consommation de viande. Diriez-vous que nous vivons une période charnière ?
C’est la première fois que la question est si largement diffusée. Elle touche, je crois, l’ensemble de la société française, bien au-delà des cercles restreints de gens qui faisaient un effort de lecture ou d’information. Mais il est important de montrer que
la contestation du carnivorisme n’est pas une question de société d’abondance, mais bien une interrogation philosophique qui a toujours jalonné les traditions de pensée. Elle était déjà vive dans l’Antiquité. L’interrogation sur la légitimité de l’abattage des animaux pour les manger, ce que Pythagore puis Porphyre ont appelé le «meurtre alimentaire», n’a pas attendu le traitement industriel des animaux pour être posée.
A l’époque, contester le «meurtre alimentaire» ou s’abstenir de manger de la viande revenait à se mettre au ban de la cité ?
C’est ce que les analyses du monde gréco-romain ont mis en évidence. Toute la vie quotidienne était rythmée par les sacrifices animaux, les refuser revenait d’une certaine manière à s’exclure du mode dominant de la cité, comme aujourd’hui dans toute société majoritairement carnivore, le régime végétarien ou végétalien est une façon de prendre position contre des habitudes dominantes.
Pour comprendre le «fait carnivore», vous passez par une longue étude du sacrifice, en mettant notamment en lumière la banalité de cette pratique.
Les lectures que j’ai faites m’ont conduite à constater qu’
il y avait lieu de contrer la doxa qui consiste à opposer, de façon assez grossière, le mauvais abattage industriel et la bonne mort sacrificielle. Je crois qu’il y a là une première mésinterprétation du sacrifice par certains de nos contemporains qui y voient quelque chose d’exceptionnel, exercé avec beaucoup de crainte, beaucoup de retenue. Or, quand on regarde ce qui se passe en Grèce ou à Rome, ou en Chine ancienne, et dans bien d’autres régions, les sacrifices sont extrêmement répandus. Et comme le dit l’historien Paul Veyne, si les dieux sont vaguement convoqués à l’arrière-plan, il s’agit de grands festins où l’on s’amuse…
Les commentateurs ont gratifié le sacrifice de significations dont il n’était pas porteur. Ce discours constitue à mes yeux la matrice théorique de l’autorisation de mettre à mort.
Vous parlez de «génie du sacrifice». Qu’entendez-vous par là ?
Le génie du sacrifice consiste d’une part en une transmutation du réel au profit d’une lecture hypersignifiante, d’autre part en une rhétorique qui captive l’esprit. Certains anthropologues n’hésitent pas à écrire que, lorsque la victime est tuée, elle est rendue à la vraie vie… Il y a donc dans cette rhétorique sacrificielle, construite par ceux qui ont observé et décrit des sacrifices plus que par ceux qui en ont pratiqué, la capacité à retourner complètement le réel, et même à s’émanciper de ce qui se passe effectivement pour tenir un tout autre discours. Certains ont l’impression de se retrouver devant une opération tout à fait singulière alors qu’il s’agit d’abattage… Une pratique somme toute très courante et qui permettait, en effet, d’avoir de la viande.
Vous notez que quasiment tous les animaux sacrifiés étaient mangés…
Il y a évidemment plusieurs motifs au sacrifice. Le sacrifice oblatif - offrir aux dieux une victime pour les remercier -, le sacrifice propitiatoire - en vue d’obtenir quelque chose - et puis il y a des sacrifices explicitement alimentaires. Il est extrêmement rare que les animaux sacrifiés ne fassent pas partie du répertoire des animaux consommés. D’après mes lectures, il semble qu’en Chine ancienne il n’y a qu’un seul cas où la victime est entièrement brûlée et où donc elle ne profite à personne.
Pour vous, l’abattage industriel relève de la structure sacrificielle ?
Je le pense. Au fil de notre histoire, on constate une accélération des mises à mort, fruit du développement des connaissances scientifiques et techniques. Tout ce qui était fait de façon un peu hasardeuse, empirique, s’est amplifié de façon inouïe au tournant de l’industrialisation grâce à la génétique et aux progrès de la zootechnie [techniques liées à l’élevage et à la reproduction des animaux, ndlr]. Mais les méthodes, elles, sont aussi anciennes que l’élevage. Comme le dit Derrida, il n’y a pas une rupture au sens historique du terme, mais plutôt l’aggravation de quelque chose qui est déjà en place.
Dans cette permanence se lit, selon vous, la façon dont l’humanité se définit au regard de l’animalité.
Pourquoi l’humanité, au moment où elle peut se passer de chair animale, institutionnalise l’alimentation carnée, la systématise, la généralise, la radicalise, l’universalise ? Au paléolithique, la chasse n’était évidemment pas gouvernée par les mêmes motivations… Mais aujourd’hui, nous choisissons de maintenir cette relation sanglante aux animaux alors que nous n’avons jamais été aussi bien informés de la profondeur de leur vie psychique ou émotionnelle. Au fond, il ne s’agit pas d’un problème nutritionnel ou économique, mais d’un problème d’ordre métaphysique.
C’est-à-dire ?
Dans la construction de la philosophie et du droit, on voit comment se met en place une définition privative de l’animal. Il apparaît dans l’histoire de la philosophie comme «celui qui n’a pas» : qui n’a pas d’âme, de langage, d’histoire, de société, etc. L’homme se place en haut et classe dans une entité appelée «animal» une multiplicité de formes de vie qui, bien souvent, n’ont rien à voir les unes avec les autres. On le voit dans l’histoire des religions qui, en dehors du jaïnisme [religion qui serait apparue au Xe siècle avant notre ère dans l’actuelle Inde], sont largement anthropocentrées. On le voit de façon encore plus nette dans le droit qui autorise les pratiques de mise à mort et la consommation des animaux.
Au moment où l’humanité se pense elle-même philosophiquement, métaphysiquement, elle le fait comme une entité qui doit se couper de ce qu’elle appelle la nature ou l’animal. Comme pour se rappeler qu’elle s’est séparée des animaux, elle les tue et les mange, en cet acte si singulier qu’est l’absorption, la digestion et l’excrétion d’êtres dont nous savons qu’ils ne sont, à bien des égards, pas si différents de nous. Comment affirmer plus radicalement une mainmise que par la manducation, c’est-à-dire le fait de manger ?
Qu’est-ce qui se joue précisément dans le fait de manger l’animal ?
C’est un anéantissement bien particulier. Il y a une chose qui est, je crois, frappante et que j’ai pu constater à l’évocation du cannibalisme : au fond, ce qui fait horreur, ce n’est pas le crime, mais le fait qu’on puisse manger notre semblable, car il y a dans la manducation de la chair de l’autre une absence totale de reconnaissance. Si, dans mon livre, je fais ce détour par le cannibalisme, c’est pour essayer de comprendre plus précisément le statut de l’alimentation zoocarnée.
Le cannibalisme met en lumière des choses que nous n’arrivons pas à penser dans l’alimentation carnée, dans la mesure où elle est complètement insérée dans notre pratique quotidienne et qu’elle semble aller de soi.
Comment l’«humanité carnivore» pourrait-elle donc sortir de l’alimentation carnée ?
Je fais l’hypothèse que si l’humanité cesse d’être carnivore, ce sera contrainte et forcée, et sans s’en apercevoir. On peut, je crois, miser sur les ressources de la cuisine, comme le montrent les simili-carnés inventés en Chine au Xe siècle. Il existe aujourd’hui tout un artisanat ou une industrie qui, à partir de tofu, de champignons, etc., imite nombre de produits carnés, mais aussi de fromages, et pourraient très bien les remplacer. Or, si l’humanité mange de la viande, c’est pour manger les animaux, une très grande majorité ne souhaite pas sortir de cette relation sanglante. Il y a ce que Derrida appelle une «structure sacrificielle» au sens structuraliste du terme, c’est-à-dire un invariant, un donné premier, mais dont les éléments peuvent varier pour autant que les relations qui les unissent demeurent. C’est là qu’intervient dans ma réflexion le marketing, qui joue un rôle absolument central. C’est lui qui, à partir des simili-carnés, aurait à convaincre les carnivores qui n’ont pas du tout envie de cesser de l’être que cette boucherie continue, que la viande est toujours là. Je crois puissamment à ce que l’on pourrait appeler l’«organisation d’un mensonge». Mais un mensonge en tous points comparable au mensonge actuel qui va dans le sens de la boucherie et qui nous montre par exemple sur des paquets de fromage une chèvre et son petit alors que l’on sait bien que l’on tue les chevreaux pour avoir du lait.
Mais pourquoi «organiser un mensonge» au lieu de dire la vérité ?
La minorité de végétariens ou végétaliens est appelée à grandir, certes. Mais des gens qui sont sensibles à la condition animale, qui jugent les images d’abattoirs abominables, ne désirent pas arrêter de manger de la viande pour autant. On doit alors s’interroger sur les motifs de cet attachement à la mise à mort des animaux. Il faut tenir compte de cette résistance et continuer à faire croire que la boucherie ne mourra pas si, un jour, de la viande cultivée, que le marketing pourrait nommer «viande fraîche», est largement commercialisée.