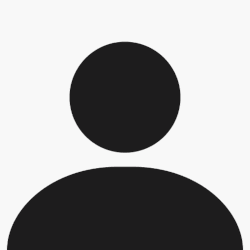texte paru dans le nº7 de la revue argelaga au sujet de la nature réelle de syriza et d'autres partis citoyennistes (tout à fait applicable à la france, le cas échéant) :
Le 4 février 2016 a eu lieu la troisième grève générale contre la réforme des pensions décrétée par le gouvernement de Tsipras, le chef suprême de la coalition Syriza. Même les bureaucraties syndicales des salariés grecs semblent se distancer des partis. Les médias ont l'habitude de comparer Syriza avec Podemos, et par opportunisme tacite, les deux formations approuvent la comparaison ; cependant, Syriza dont le noyau principal est un des deux partis communistes grecs, ressemble davantage a Izquierda Unida, la figure espagnole la plus représentative du néostalinisme. Les deux défendent une ligne social-démocrate quasi identique à celles des partis socialistes, ils sont pro-européens et partisans d'un modèle de capitalisme favorable aux classes moyennes, disposé à subventionner ses représentants et à réduire l'agressivité envers les masses populaires.
Syriza se présentait comme la solution de rechange après les échecs des partis traditionnels dans la renégociation de la dette étatique, remportant des élections dont le taux d'abstention atteignit 45% (ne pas voter est illégal en Grèce). Légitimés par les votes récoltés, ils se rendirent à la table de négociation avec la Troïka convaincus de posséder une force morale capable de faire plier les créanciers et ainsi obtenir une remise de la dette et des prêts presque sans contre-parties. Ils firent même recours à un référendum afin de prouver à leurs créanciers que le peuple grec ne souhaitait rien d'autre. La morale est bien peu de chose lorsque le rapport de forces est défavorable. Tsipras devait faire son choix : rompre les négociations ou payer ses dettes, c'est-à-dire, sortir de l'euro ou accepter les mesures d'austérité qu'on lui exigeait. Sortir de l'euro signifiait rien de moins que sortir du capitalisme et dissoudre l'État, en particulier les forces de l'ordre y compris les partis fascistes, en organisant une production autogérée et une défense par des milices populaires.
En Grèce, la crise a fait éclore un mouvement autogéré visible dans la prolifération, en marge des institutions, d'occupations de logements, de dispensaires gratuits, d'ateliers, d'écoles, de jardins potagers urbains et d'usines autogérées, de réseaux indépendants de distribution d'aliments, d'assistance juridique et de restaurants collectifs... L'argent n'est pas utilisé et beaucoup sont ceux qui retournent à la campagne, refusent de payer des loyers ou ne payent ni la facture d'électricité, ni les tickets de bus, qui sabotent les péages d'autoroute, aident comme ils le peuvent les réfugiés et affrontent les groupes d'Aube Dorée... Ce n'est pas la révolution, mais c'est tout de même révolutionnaire. Les bases pour l'autogestion généralisée sont bien là, mais quoi qu'il en soit Syriza serait pour l'étatisation généralisée, jamais pour l'autogestion, et pour ce faire les finances internationales sont plus utiles que les collectifs organisés en assemblée. La ligne rouge de Syriza est précisément l'autogestion. Syriza croit en les institutions, pas en l'autonomie ; Syriza représente un secteur de la société qui attend tout de l'État et donc se sent plus proche de la bourgeoisie que du peuple exploité. Défenseur de l'"intérêt général" incarné par l'État grec, il choisit l'austérité, les coupes budgétaires et l'augmentation des taxes, la réactivation de l'exploitation minière hypercontaminante en Chalcidique, la répression policière et l'expulsion des réfugiés vers la Turquie.
Il s'agit là probablement d'une grande leçon de réalisme politique et de "démocratie" citoyenniste dont les enseignements seront appliqués par les leaders de Podemos avec la plus grande énergie au cas où la crise espagnole mettrait en danger l'appareil d'État et suivrait un chemin révolutionnaire semblable à celui en Grèce.